Colloque historique : “Coups de force en Indochine 1945-1950”

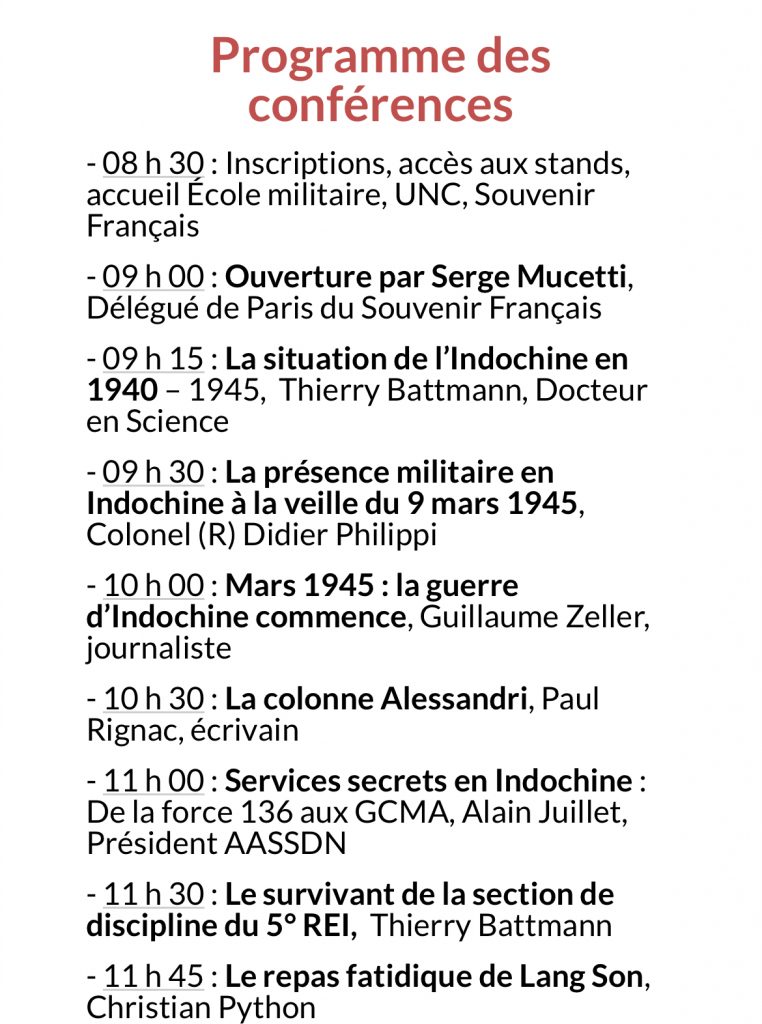

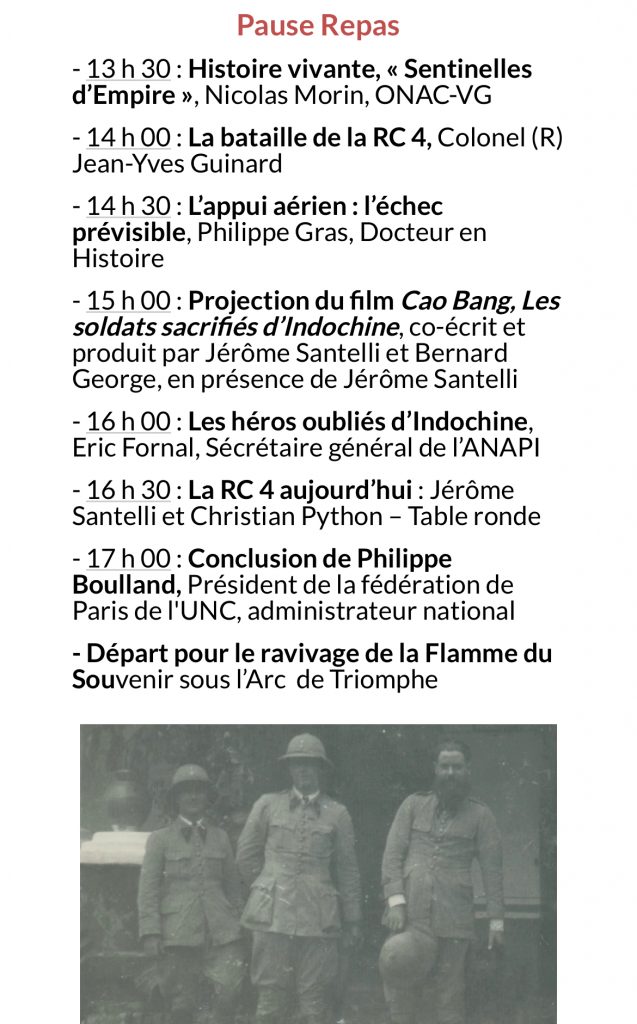


Views: 136
Colloque historique : “Coups de force en Indochine 1945-1950” Lire la suite »

Le contrôleur général des armées (2S) Philippe de Maleissye et le bureau de l’ANAPI sont heureux de vous inviter à la cérémonie du souvenir des prisonniers du Viêt-Minh morts en captivité.
Vous trouverez à cet effet un carton d’invitation au format PDF joint à cette publication.
Cette cérémonie se déroulera le samedi 11 octobre 2025 à 14h30 à Morsang-sur-Orge (91), parc Simone Veil.
La mise en place du dispositif débutera à partir de 14h00.
Elle sera présidée par madame Marianne Duranton, maire de Morsang, en présence de représentants de l’Etat et élus du département et de la municipalité.
A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur réunira tous les participants.
Un plan des lieux vous sera adressé ultérieurement par voie électronique après confirmation de votre présence.
CGA (2S) Philippe de Maleissye
Président de l’ANAPI.
__________________
cliquez pour télécharger le CARTON D’INVITATION AU FORMAT PDF
Views: 52
À l’espace Beaulieu – 145 rue Saint Genès – Bordeaux. 20h/22h
Conférencier : Lieutenant-colonel (r) Philippe Chasseriaud
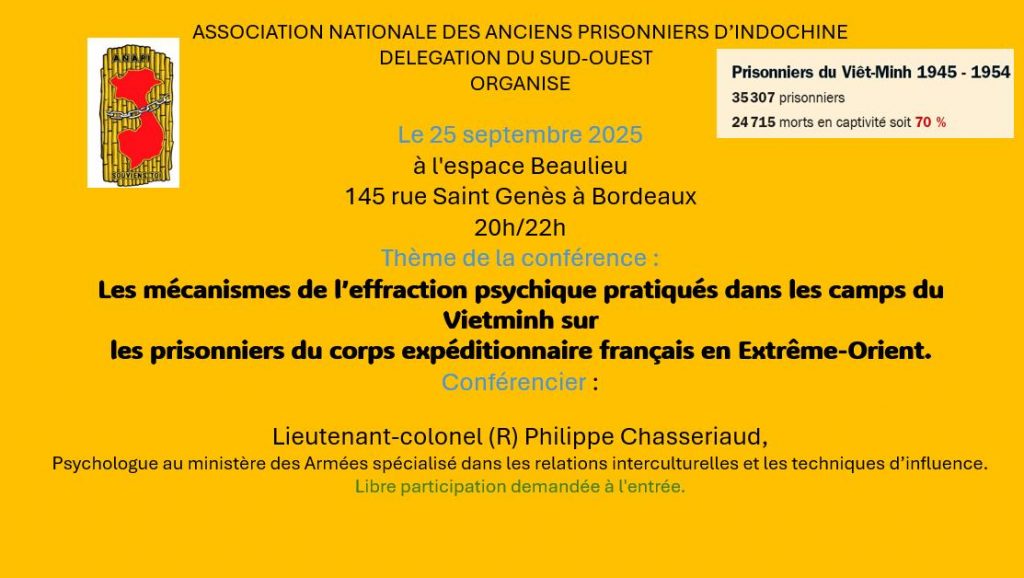
Views: 43
Conférence ANAPI sud-ouest le 25 septembre 2025 Lire la suite »

Bernard Grué nous a quittés le 11 juillet 2025. Rescapé des violents combats de la RC4 et des camps de rééducation du Viêt-minh, il fut aussi un grand serviteur de l’état, notamment dans le renseignement au sein du SDECE. Retour sur un parcours exceptionnel…
Bernard Grué est né le 24 décembre 1924 à Bordeaux. Le 28 novembre 1945, il décide de s’engager au titre de l’Ecole Spéciale Militaire de St Cyr. Conformément aux pratiques de l’époque, il effectue préalablement un stage en corps de troupe comme sous-officier.
Le 16 janvier 1947, le sergent Grué rejoint enfin Coëtquidan et est admis à l’Ecole Spéciale Militaire Interarmes.

Ayant choisi l’infanterie à l’issue de sa formation, il rejoint la Légion étrangère et Sidi Bel Abbés le 20 novembre 1948. Le 22 mai 1949, il embarque sur le Pasteur à destination de l’Extrême-Orient. Débarqué à Saïgon le 7 juin, il est affecté au 3ème régiment étranger.
Il prend alors le commandement du poste 41, situé sur la RC4. A Dong Khé, du 16 au 18 octobre, le lieutenant Grué défend avec acharnement son point d’appui face à un ennemi très supérieur en nombre. Alors que celui-ci a pris pied dans la citadelle de Dong Khé, il parvient à le mettre en déroute en servant lui-même un canon de 57.
Le 18 au matin, après deux jours de résistance héroïque, sur sa position encerclée et écrasée par l’artillerie, le lieutenant Grué est une nouvelle fois blessé. Inconscient parmi ses légionnaires morts et blessés, il est alors capturé par le Viêt-minh.
Suivent 4 années de captivité et de rééducation au camp n°1 dont il fait le récit dans son livre « l’espoir meurt en dernier », un récit sans haine, teinté d’humour et d’un incroyable optimisme. Libéré le 28 août 1954, il est rapatrié vers la France et débarque à Marseille le 4 octobre 1954.
Bénéficiant d’un congés de fin de campagne et de convalescence jusqu’à la fin mars 1955, il est alors affecté en novembre à l’état-major des forces armées à Paris. Diplômé des langues orientales en Persan, puis breveté de l’enseignement militaire supérieur, le capitane Grué part pour l’Algérie d’où il revient pour intégrer le centre militaire d’études slaves. Par la suite, il rejoint Théhéran où il suit les cours de l’école de guerre iranienne.
Après avoir été attaché militaire adjoint à Moscou de 1968 à 1971, il prend ensuite le commandement du 46ème régiment d’infanterie à Berlin de 1972 à 1974, puis à son retour en France, la direction du renseignement au sein du Service de documentation extérieure et de contre-espionnage (SDECE).
En 1978, il quitte l’armée avec le grade de colonel.
Il effectue par la suite une seconde carrière dans un grand groupe pharmaceutique.
Le 30 avril 2024, à l’occasion de la cérémonie de Camerone à Aubagne, le colonel Grué est désigné pour porter la main du capitaine Danjou, ultime reconnaissance accordée à un grand soldat ayant servi à la Légion étrangère.

Le colonel Grué s’est éteint à l’âge de 100 ans à l’Institution Nationale des Invalides où il était pensionnaire depuis 2017.
La Légion étrangère a perdu l’un de ses héros d’Indochine … et la France un de ses grands soldats.
Views: 151
Le colonel Bernard Grué, défenseur héroïque de Dong Khé, n’est plus… Lire la suite »
Témoignage de Marcel Schneyder

Le 9 mars 1945, je me trouvais à Gia-Dinh-ville, dans la proche banlieue au Nord de Saïgon, Chef-lieu de la province de Gia-Dinh.
Mon père, René Schneyder, administrateur des services civils d’Indochine, était depuis 1942 le chef de la province de Gia-Dinh.

Les Américains avaient reconquis les Philippines. Depuis le début de l’année, les bombardements américains sur Saïgon devenaient presque quotidiens. C’est ainsi qu’ils coulèrent tous les bateaux japonais qui se trouvaient dans le port de Saïgon jusqu’à Nha-Be, au confluent de Don Nai.
Le gouverneur de la Cochinchine avait ordonné aux Français d’envoyer leurs enfants à Dalat pour les préserver des bombardements mais ma mère avait refusé, ne voulant pas se séparer de ses enfants. C’est ainsi que mon frère et moi, nous étions à Gia Dinh avec nos parents le 9 mars 1945.
Craignant que les Français ne se révoltent pour aider les Américains en cas de débarquement de leurs troupes, les Japonais décidèrent alors le fameux « coup de force du 9 mars 1945 » pour mettre fin à la souveraineté française. Désormais l’Indochine, dernier territoire du Sud-Est asiatique encore sous la souveraineté d’un pays occidental, subit le même sort que les possessions anglaises (Hong-Kong, Malaisie, Birmanie), américaines (Guam, Philippines), hollandaises (Indes néerlandaises), conquises en 1942.
Dans la nuit du vendredi 9 mars 1945, les Japonais attaquèrent les casernes de l’armée française. Après une défense acharnée, infligeant de lourdes pertes aux Japonais, les soldats français durent se rendre face à la supériorité des troupes japonaises.
Les Japonais firent prisonnier l’Amiral Decoux, Gouverneur général, qui avait refusé énergiquement l’ultimatum japonais. Tous les hauts fonctionnaires français furent également faits prisonniers.
A Gia Dinh, un colonel japonais envoya à mon père, chef de la province, un interprète pour lui signifier officiellement le nouvel ordre imposait désormais par l’armée japonaise et procéder à son arrestation. Ils l’emmenèrent alors dans un endroit inconnu pour l’interroger.
Ma mère, mon frère et moi fûmes alors gardés à la résidence par des sentinelles japonaises, empêchant toute personne d’y pénétrer.

Nous étions vraiment isolés de tout et à la merci des soldats japonais. C’est ainsi que j’ai passé mon anniversaire « en prison ». J’avais alors 15 ans et mon frère 12 ans !
Au bout d’un mois, les Japonais nous dirent de « foutre le camp » et de rejoindre immédiatement Saïgon. En effet, les Japonais avaient décidé de regrouper les Français dispersés à travers toute l’Indochine dans les capitales (Hanoï, Saïgon, Hué, Phnom Penh) pour mieux les surveiller.
En Cochinchine, les Français qui avaient pris le train pour rejoindre Saïgon se heurtèrent à leur arrivée à des manifestations d’Annamites à la gare de Saïgon, qui vociféraient, les injuraient, voire crachaient sur eux.
Ceux qui n’avaient pas de logement à Saïgon durent en trouver au sein de leur famille, chez leurs amis ou collègues. Les gens se retrouvèrent ainsi à plusieurs familles dans une seule villa !
Quant à nous, nous eûmes beaucoup de chance : ma tante maternelle nous céda son « compartiment » qui comportait deux pièces seulement.
Chaque habitation devait afficher une planche en bois fournie par la gendarmerie japonaise indiquant les noms des occupants.
Les Japonais avaient imposé un couvre-feu de 8h00 du soir à 8h00 du matin. On se déplaçait à pied ou à bicyclette dans un périmètre limité par l’arroyo de l’Avalanche au Nord, par l’arroyo chinois au Sud, par la rivière de Saïgon à l’Est, la rue de Verdun et la place du marché à l’Ouest.
Mon père, comme tous les Français, « était au chômage » et nous vivions sur ses économies. Cela dura 6 mois jusqu’à la capitulation du Japon le 15 août 1945, ordonnée par l’Empereur.

Les Japonais avaient donné l’ordre de creuser devant chaque habitation des tranchées pour nous abriter contre les bombardements américains.
Les avions américains volaient trop haut et manquaient souvent leur cible. C’est ainsi que voulant bombarder la gare de Saïgon, ils touchèrent les compartiments de la rue Chasseloup Laubat devant le cercle sportif français, situés à 1 kilomètre de la gare. Tous les occupants furent tués !
Nous avons nous-mêmes failli être tués car nous habitions rue Testard, rue parallèle à la rue Chasseloup Laubat, à 100 mètres des habitations bombardées. Notre tranchée trembla et nous fûmes très secoués. Le bombardement eut néanmoins pour conséquence de me rendre sourd de l’oreille droite !
Le 2 septembre 1945, Ho Chi Minh proclama l’indépendance du Vietnam. Le Viêt-Minh organisa alors à Saïgon une grande manifestation : 200 000 hommes, femmes et jeunes vinrent défiler avec des banderoles et des pics en bambou dans les rues de Saïgon. Nous étions effrayés dans nos habitations.
La journée se termina tragiquement : place de la cathédrale, le père Tricoire, aumônier des prisons, fut poignardé et achevé au révolver sur le seuil de la Cathédrale où son corps resta plus d’une heure les bras en croix.
Le 23 septembre, le Viêt-Minh organisa à nouveau un massacre à la cité Héraud : 300 français (blancs et métis) furent enlevés dont 150 tués dans des conditions horribles.
Le 5 octobre fut un immense soulagement avec l’arrivée à Saïgon du corps expéditionnaire commandé par le Général Leclerc, venu reconquérir l’Indochine.
Ainsi commença ma guerre d’Indochine qui devait durer 9 ans et se terminer par la défaite de Dien Bien Phu en 1954.

Views: 187
Saïgon, 9 mars 1945 : le coup de force des Japonais vécu par un adolescent Lire la suite »

Aucun conflit n’a été autant décrié que la guerre d’Indochine ; non seulement la guerre elle-même mais également ceux qui y ont pris part. Ce qui fut mon cas dès octobre 1948.
Mon engagement n’avait rien de politique ou une quelconque volonté de permettre à la France de conserver la perle de son empire colonial. Mon unique motivation était de courir l’aventure. J’étais un adolescent de l’Occupation, à la fois trop jeune pour craindre le STO ou prendre part à la Résistance ; A Paris les maquis n’étant pas tellement nombreux.
Pour les jeunes de cette époque, cette période était particulièrement étouffante car toutes activités, tous loisirs étaient étroitement surveillés et les interdits innombrables. La Libération puis la paix retrouvée n’améliorèrent pas grand-chose, les partis politiques ayant repris leurs petits jeux stériles de la 3ème République. L’horizon étant bouché, l’aventure était une échappatoire dont l’Indochine en était la porte.
Premiers contacts avec l’Indochine :
Je me suis tout d’abord retrouvé le 24 février 1948 à St Brieuc où le 3ème bataillon colonial de commandos parachutistes (BCCP) était en formation (n° de brevet 22418). De jeunes officiers, quelques anciens et des centaines de jeunes de moins de 20 ans, pas tellement conscients de ce qui les attendait, y étaient rassemblés. Pour ma part, mon supérieur était un certain Capitaine Bigeard qui, par la suite, a su remarquablement soigner sa popularité.
Honnêtement, je ne peux parler de cette guerre que sur la seule période où je l’ai moi-même vécue. Celle-ci commence le 8 novembre 1948, jour où le Pasteur arriva au Cap Saint Jacques et se termine le 15 octobre 1950, date à laquelle je fus fait prisonnier lors de la désastreuse bataille de la RC4. Certes, il y eut après 15 mois de captivité dans les camps de rééducation de Viet Minh … mais c’est une autre histoire.
A mon arrivée et Jusqu’à la fin de 1949, l’armée française dominait la situation. Nous étions certes moins nombreux mais mieux armés, même si notre armement était hétéroclite, nos équipements médiocres et nos véhicules datant de la campagne d’Italie. Par ailleurs, nous pouvions compter sur une puissance de feu supérieure et un encadrement de valeur.
Toutefois, après la victoire des Communistes en Chine, cette supériorité commença à s’estomper. De la frontière chinoise partaient désormais clandestinement des convois complets d’armement et de matériels. Bien vite, nous nous sommes retrouvés en état d’infériorité, tant en armement, qu’en combattants.
Après avoir participé à quelques combats locaux, la première véritable opération à laquelle prit part mon groupe de commandos (GC), soit l’équivalent d’une forte compagnie, commença le 20 janvier 1949 pour se terminer le 24 juillet suivant. Parachutés en Haute Région dans le secteur de Son La, nous avons rayonné 6 mois durant dans une région montagneuse où quelques postes militaires disséminés assuraient la présence française.
Si la population ne nous était pas ouvertement favorable, elle n’était pas pour autant hostile. Ces pauvres gens étaient pris entre le marteau et l’enclume. Chaque jour nous allions d’un village à l’autre, respectueux des coutumes locales, payant scrupuleusement tout ce que nous consommions, assurant les habitants que notre soutien leur était acquis et que nous étions prêts à prendre leur défense si besoin était. Ils acceptaient ces bonnes paroles avec un franc sourire, le même qu’ils réservaient aux patrouilles viêts qui ne manqueraient pas de leur rendre visite peu après notre départ. Les Viêts s’imposaient par la peur, nous tentions de nous imposer à l’aide d’un paternalisme dépassé. Malheur au chef de village soupçonné de s’être montré trop complaisant avec nous ! Il risquait alors d’y laisser sa peau.
A cette époque, la guerre n’avait rien de spectaculaire : pas de batailles à proprement parler, pas d’affrontements violents, pas de coups d’éclat. C’était l’époque des embuscades soudaines et souvent meurtrières au détour d’une route, d’une piste. Un feu bien nourri, quelques tirs de mortier, c’était bref et imparable !
Toutefois, nous ne sommes pas restés longtemps des victimes et avons bien vite appris, nous aussi, à tendre des embuscades et à déjouer celles qui nous avaient été tendues. Bigeard nous avait préparé à ces pièges au camp de Meucon. Combien d’embuscades de jour et de nuit avons-nous tendues d’un commando à l’autre ! Dieu sait si alors nous avions râlé contre ces “jeux de cons”. Rétrospectivement, ce n’était pas du temps perdu et beaucoup de vies furent ainsi sauvées.
Les mines, que les Viêts nous collaient partout, étaient l’autre plaie de cette guerre larvée : ouvrir une porte dans un village désert, comme cheminer sur une piste, tout était risqué et devenait une aventure. S’ils avaient été experts dans la fabrication et la pose des mines, nous aurions subi encore plus de pertes ! Les mises à feu étaient artisanales, par pression généralement ou bien par un gars planqué dans un fourré qui tirait sur une ficelle et alors tout pétait ! Tout cela générait beaucoup mais vraiment sans rapport avec le nombre de mines posées.
Durant cette première opération, notre base arrière avait longtemps été Na San. Une piste d’atterrissage de 600 mètres de long en terre battue y avait été construite par les Japonais. C’était bien suffisant pour les vieux JU 52 ou les Bristol qui ravitaillaient Son La et tout le secteur. Jamais les Viêts n’ont attaqué le terrain car, bien qu’il nous soit nécessaire, il était certain que des avions civils venaient également les ravitailler en toute discrétion.
Le fait que le poste de Na San n’était pas un de leurs objectifs nous a un jour été particulièrement favorable. Un soir de mai, un gars avait voulu allumer la boite de corn-beef emplie de pétrole qui servait d’éclairage à une autre boîte. Il s’y est pris comme un manche et a mis le feu à toute la baraque construite en bambou et en paille. Tout a flambé en quelques minutes. Le drame était que les armes et tout le matériel avaient également flambé. Dès lors, pour tout armement, nous n’avions plus que les quelques PM des sentinelles déjà en place. Si les Viêts nous avaient attaqués ce soir-là nous étions cuits. Evidemment, peu après, une grosse pluie a éteint les braises et nous a copieusement saucés.
Le lendemain matin, un JU 52 qui pointait à l’horizon a vite renoncé à son atterrissage et a filé sans demander son reste. Il nous a fallu aller à pied jusqu’à Son La, pratiquement sans armes, distant d’une dizaine de kilomètres. Ce jour-là encore, la chance était avec nous car aucune embuscade n’avait été installée sur la route. Hanoï, prévenu par radio, nous a par la suite expédié rapidement tout l’équipement nécessaire.
Pendant 6 mois complets, nous avons sillonné en long, en large et en travers cette région magnifique où les habitants, bien éloignés de toutes considérations politiques, auraient tellement souhaité qu’on leur fiche une paix royale. Ils ne demandaient rien à personne, ils n’étaient ni pro-Viêt, ni pro-Français, seulement de très braves gens très attachants, bien loin de toute guerre. Vivant intégralement sur le pays, jamais la moindre boîte de ration ne nous a été expédiée ; uniquement du Buffle, de la volaille … et l’inévitable riz dont on finissait par se lasser, c’est humain ! En dépit de fruits nombreux et variés, nous rêvions d’une nourriture plus “civilisée” et aurions volontiers échangé la part de paradis de notre député contre un steak frites et un camembert à point.
La seule chose qui nous était volontiers allouée, c’était le sel, denrée très rare en Haute région. Pour le sel, pas besoin de parachute, il était tout simplement droppé. Avec lui on pouvait tout faire : enrôler, bon gré mal gré, un gars du coin, lui faire transporter une charge toute la sainte journée et si le soir on lui donnait deux poignées de sel, il vous aurait baisé les pieds. Combien de vertus locales ont chancelé pour un ou deux kg de sel !!!
Un officier payeur venait régulièrement payer nos soldes … Pourquoi faire ? Nous n’avions aucune occasion de dépenser quoi que ce soit ! En revanche, cet officier qui était venu au risque de sa vie accomplir sa mission, était sûr de mériter une médaille !
Nous avons perdu là-bas pas mal des nôtres, notamment deux officiers, les lieutenants Lhuillier et Valet de Peyraud. Lorsque nous avons enfin regagné Hanoï, le 24 juillet 1949, le Colonel Lajoie qui commandait le secteur nous a généreusement décerné une croix de guerre, tout en regrettant notre départ. Notre présence, 6 mois durant, avait assuré sa complète tranquillité.
A Hanoï, le 3ème BCCP séjournait au Lycée du Protectorat, superbes bâtisses au confort assez sommaire, mais nous étions chez nous. Le Capitaine Bigeard, qui ne s’entendait vraiment pas avec le chef de corps, le Commandant Ayrolles, dit Pan-Pan, avait obtenu une mutation dans cette Haute région que nous venions de quitter. Le Lieutenant Leroy, qui lui avait succédé, s’intégra vite à son unité. Le Lieutenant Rougier, qui avait pris la tête du 2e Commando après la mort du Lieutenant Lhuillier, était un officier remarquable. Sa carrière fût brisée par ses 4 années de captivité car il aurait dû aller loin. Je l’avais surnommé Méphisto à cause de ses lunettes teintées et son air légèrement renfrogné. Tous ses gars l’auraient suivi jusqu’en enfer.
Un séjour d’une quinzaine de jours nous fût accordé à Vat Chay dans la Baie d’Along, cadre enchanteur, bulle coincée à longueur de journée, une mer à 28 degrés, un paradis bien trop court ! Il nous a vite fallu rejoindre Haïphong où le vieux tortillard, qui sautait régulièrement sur une mine, nous a ramenés à Hanoï. D’autres missions nous attendaient.
Jusqu’à présent, nous avions mangé notre pain blanc : différentes sorties le long du canal des Rapides, à moins que ce ne soit le Canal des Bambous, une opération amphibie dans la région Vinh en Annam, débarquement style “le jour le plus long“, sous la protection de je ne sais quel navire de guerre, destruction des salines. Nous sommes repartis sans nous préoccuper du sort des internés civils, prisonniers depuis des années. Qu’aurions-nous pu faire pour eux ? Ils avaient été mis au vert dès les premiers coups de feu de décembre 1946.
En septembre ou bien en octobre, nous avons effectué un saut d’entretien. Il était nécessaire que nous sautions régulièrement pour pouvoir continuer à bénéficier de la solde à l’Air d’un montant intéressant. A vrai dire, je me serai bien passé de ce saut car je détestais sauter en parachute, ayant le plus abominable des vertiges sur le premier barreau d’une échelle. L’entraînement au sol a été pour moi un véritable calvaire et chaque saut une redoutable épreuve, mais je m’étais engagé chez les paras et il était hors de question que je me dégonfle.
Avec de nombreuses sorties surprises en opération interarmes soigneusement préparées, le temps s’écoula rapidement, nous approchant des fêtes de fin d’année. Nous nous réjouissions de fêter la Noël et la venue d’une nouvelle décennie dans d’agréables conditions. Hélas, il n’en fût rien ! A Hanoï, un certain Colonel Chavatte, pour une raison que j’ignore et qu’il ignorait peut-être lui-même, avait pris en grippe notre 3ème BCCP. Il n’existait pas de coins pourris où il ne nous ait expédiés à la seule fin d’être débarrassé de notre présence. Par ailleurs, il refusait systématiquement la plus grande partie des propositions de citations qui lui était soumise. Commandant les troupes aéroportées en Indochine, c’était peut-être un officier de valeur mais, de notre point de vue, c’était un sale con !
C’est ainsi que peu avant Noël, nous avons été expédiés je ne sais trop où pour une opération dont la haute portée tactique m’échappe encore. Le Colonel Chavatte a pu ainsi passer d’agréables fêtes de fin d’année sans que la présence du 3ème BCCP ne lui donne de l’urticaire.
Heureusement pour nous, l’intendance avait eu pitié de nous et, pour l’occasion, nous avait parachuté de quoi marquer le coup. Abondance de biens ne nuit pas dit-on ? … mais là, ils avaient un peu forcé la dose, tant et si bien qu’au petit matin les gueules de bois étaient légion. Pour éviter que la beuverie ne se prolonge, le Lieutenant Leroy fit récupérer l’intégralité des bouteilles épargnées et les brisa toutes !
Nous avons regagné Hanoï peu après. Pour nous, une nouvelle année commençait, le pire nous attendait…
En Haute Région, le poste de Nghia Do avait été attaqué par des forces viêts importantes, bien décidées à s’emparer du Poste. Une force d’intervention fût rapidement constituée avec deux GC des 3ème et 5ème BCCP sous les ordres du Commandant Grall. La situation des assiégés était désespérée car les Viêts s’étaient emparés d’une partie du poste dont le chef avait été tué. Le 24 février 1950, le parachutage fut une réussite quoiqu’un peu merdique, un JU 52 s’étant égaré et à deux doigts de larguer ses paras sur Pa Kha à 50 km de là.
Les Viêts ayant été mis en déroute, le poste fut repris. C’était une belle opération, bien que sa portée soit en définitive limitée, Nghia Do devant être abandonnée peu après.
Le temps exécrable (pluie et crachin) rendait toutes sorties particulièrement pénibles. Pitonner dans de telles conditions était un exploit. Quand on parvenait à escalader quelques mètres, on en redescendait sur le ventre, parfois deux fois plus bas, toujours trempés sans aucune possibilité de se sécher. Les Viêts, furieux de s’être fait virer du poste, ne nous laissaient aucun répit.
Un détachement fut alors chargé de transporter les morts et les blessés. Ces derniers devaient impérativement être amenés à Lao Kay pour être hospitaliser à Hanoï. Notre itinéraire nous faisait passer par un point sensible, Bao Ngay, que nous ne sommes jamais parvenus à franchir. Les Viêts y étant trop nombreux et puissamment armés, nous avons dû renoncer. Il y eut à nouveau des morts et certains blessés moururent faute de soins urgents.
Il n’y avait rien à attendre des éléments français présents dans la région, bien trop préoccupés à assurer leur propre sécurité. Nous avons rejoint Pa Kha, une petite bourgade cernée de champs de pavots où il fallut en raser une grande surface pour permettre l’atterrissage des Morane 500 sanitaires et sauver ainsi les blessés qui étaient parvenus à tenir le coup.
C’était la période de Pâques. Un ou deux parachutages avaient permis d’améliorer un peu l’ordinaire, de remplacer du matériel, de percevoir des munitions, mais aussi de récupérer un peu … les semaines passées avaient été éprouvantes !
Puis nous sommes repartis en direction de Lao Kay en passant par Bao Ngay les doigts dans le nez. Nous nous imaginions à Hanoï le soir même ou au plus tard le lendemain. Bien qu’effectivement embarqué dans nos vieux JU familiers, il nous fallut alors déchanter. Le Haut Commandement n’étant jamais avare de bonnes surprises, plutôt que d’aller à Hanoï, Cao Bang fût finalement notre destination. Sacrée douche froide qui ne fût pas du goût de tout le monde … Servitude militaire … il faut savoir fermer sa gueule !
Je n’ai pas vraiment compris ce que nous étions venus faire dans cette galère, logés dans des baraquements délabrés. Histoire de nous occuper, on nous envoyait crapahuter un jour à l’est, un jour à l’ouest mais jamais au nord. Les Viêts y étaient très nombreux et bien mieux armés que nous. Nous n’étions pas de taille à nous mesurer à eux de toute évidence. Cao Bang n’en avait plus pour bien longtemps et son évacuation, quelques mois plus tard, devait valoir au Corps Expéditionnaire une cuisante défaite et mener à l’anéantissement du 3ème BCCP.
Nous sommes finalement rentrés à Hanoï, pas pour bien longtemps, une nouvelle tâche allait nous être confiée et pas la moindre !

La reprise de Dong Khê :
Fin mai, les Viêts, toujours plus actifs, sûrs de leur supériorité, tant en hommes qu’en armement, avaient pris d’assaut la place de Dong Khê, un poste solide, tenu par les légionnaires du 3ème REI, des coriaces. Pourtant, ils n’étaient pas parvenus à résister à l’assaut et le poste avait été investi après d’âpres combats. Bien qu’il s’agisse d’une place forte importante sur la RC4, le Haut Commandement tergiversait et hésitait quant à l’envoi des parachutistes pour rétablir la situation. Ce n’est que vers la fin de l’après midi que l’ordre nous fût donné. Nous étions sur le terrain de Bach mai depuis tôt le matin, prêts à partir. Le 27 mai 1950, après une heure de vol nous étions sur place, parachutés à 100 mères, avec un regroupement immédiat. Pour une fois le 3ème BCCP opérait au complet. Chaque GC avait son objectif précis. Pour nous, GC 2, c’était la reprise de la citadelle.
La DZ était au pied de cette citadelle. Nous avons foncé au pas de charge sur la route d’accès des camions, canardant à tout va. Les Viêts ne nous attendaient plus, étant tranquillement en train d’embarquer leur butin. Sans leur donner le temps de réagir, nous sommes passés maîtres de la situation. Victoire ultra rapide et totale, la plus belle opération aéroportée de toute la guerre d’Indochine. Plus tard, alors que j’étais prisonnier, un officier Viêt, sachant que j’avais appartenu au 3ème BCCP, me demanda si j’avais participé au saut sur Dong Khê. Il me confia alors que lors de l’investissement du poste, prévoyant un parachutage, ils nous avaient préparé un comité d’accueil particulièrement soigné avec des mitrailleuses qui balayaient la DZ. Un quart d’heure avant notre arrivée, ils avaient réembarqué les mitrailleuses en question. Nous avons eu, ce jour-là, un coup de chance monumental. Leurs mitrailleuses, si elles avaient été maintenues en place, auraient fait alors un véritable carnage, aussi bien pendant la descente que lors de l’arrivée au sol. Fort heureusement pour nous, quelques minutes avaient suffi pour assurer notre victoire et prolonger de quelques mois la survie de notre unité.
Pendant plusieurs jours, nous avons patrouillé dans le coin mais les Viêts s’étaient volatilisés. Les Tabors sont alors venus nous relever. C’étaient de redoutables combattants, vétérans de la Campagne d’Italie qui, sous les ordres du Général Juin, étaient parvenus à forcer le passage à Casino, là où les Américains piétinaient depuis des semaines.
Peu après, nous avons regagné Hanoï. Notre séjour approchait de son terme. En 18 mois de présence en Indo, nous n’avions pas chômés. Que d’opérations, que de Kms parcourus ! Combien de fois le destin nous avait été favorable, sans jamais avoir été abandonné par la chance ! Terriblement attachés à ce pays, nous étions devenus des hommes, bien loin des jeunes gars de 20 ans partis courir l’aventure à l’autre bout du monde.
La vie au Protectorat, notre base arrière, était confortable. Hanoï était une ville très agréable où chacun d’entre nous y avait ses habitudes, son bistro préféré, son dancing attitré. Comme nous étions souvent au diable, sans guère de possibilités de dépenser notre solde, nous étions assez nantis lors de nos séjours en ville.
Il nous restait encore six mois à tirer, sans savoir ce qui nous attendait. Jamais nous n’envisagions le pire. Personnellement, il ne m’était jamais venu à l’idée que je ne puisse pas rentrer en France. La mort certes, nous la côtoyons quotidiennement, mais ce n’était pas une obsession, tout au plus une éventualité lointaine.
Je bénéficiais alors d’une sorte d’entracte forcé à la suite d’une nouvelle dysenterie. Un besoin de soins énergiques nécessita une hospitalisation à l’Infirmerie de la Base Aéroportée Nord (BAPN) : lit douillet, piqûres douloureuses, infirmières parfois sympas, nourriture “hospitalière”. Je fus rapidement rétabli puis expédié pour une quinzaine de jours au centre de repos de Vat Chay où le bataillon avait séjourné en août l’an passé. Même cadre enchanteur, même bulle aussi solidement coincée… Comme on était loin des pistes du Tonkin, des rizières et des pitons, des buffles hargneux et non comestibles … c’est la vie de château, pourvu que ça dure ! Hélas ça n’a pas duré et j’ai bien vite repris ma place au sein de mon cher 2ème commando auquel j’étais resté fidèle depuis mon enrôlement.
Ma place était au milieu des copains, pas dans un lit d’hôpital ou en centre de repos. Cet entracte, même s’il me fût salutaire, aurait été comme une tache sur mon palmarès s’il s’était prolongé. Je n’avais jamais raté une opération ou échappé à une sortie et je voulais qu’il en soit ainsi jusqu’à mon retour.
Pour une fois, nous étions restés à Hanoï, pas une éternité mais plus longtemps qu’à l’accoutumé … le Colonel Chavatte devait être en permission ? Grand bien lui fasse ! Se frotter à la vie civilisée n’avait rien de désagréable. Une boisson fraîche à la terrasse de la Taverne Royale et le sourire d’une jolie fille étaient des joies simples auxquelles nous ne nous étions guère habitués, raison de plus pour en profiter pleinement. Et puis septembre est arrivé, marquant la reprise des combats. C’est un peu comme si tous les belligérants prenaient leurs vacances en août !
Le poste de Dong Khé, que nous avions récupéré de haute lutte en mai dernier, avait été repris par les Viêts. Même les Légionnaires du 1er BEP, notre Bataillon frère, n’étaient pas parvenus à les en déloger. Par ailleurs, le Haut Commandement, après bien des tergiversations, avait décidé l’abandon de Cao Bang et son évacuation par les militaires, mais aussi par les civils qui constituait dèslors un objectif quasi irréalisable.
La RC4 avait été surnommée “la route de la mort“. Des dizaines de convois y avaient été anéantis au cours de sanglantes embuscades.
Je n’avais rien d’un fin stratège, je n’avais pas suivi les cours de l’Ecole de guerre et je n’avais fait partie d’aucun état-Major. Je n’étais qu’un modeste sous-officier parachutiste possédant néanmoins suffisamment d’expérience pour deviner qu’avoir la prétention de vouloir acheminer une colonne aussi importante sur un trajet aussi long n’était pas seulement inconscient mais complètement criminel.
Celui qui avait pris une telle décision aurait mérité d’être passé par les armes. J’imagine, bien au contraire, que le responsable en question a sans doute poursuivi une belle carrière et est mort dans son lit, ayant droit aux honneurs militaire lors de ses obsèques.
Un autre itinéraire était pourtant envisageable par la RC 3. Celle-ci, en passant par Thai Nguyen, avait un accès direct à la Moyenne région et, de plus, l’avantage de ne pas longer la frontière de Chine d’où la colonne risquait d’être attaquée sans même pouvoir riposter. L’incurie l’emporta sur la raison et la colonne Charton se mit en marche.
De That Khé, une colonne de secours aux ordres du Colonel Le Page fut formée et se mis en route pour venir en aide à la colonne Charton. Les deux colonnes ne parvinrent jamais à faire leur jonction et des combats féroces se déroulèrent, causant des pertes considérables. Des unités de grandes valeurs, telles que le 1er BEP, le 3ème REI et les Tabors, furent massacrées par un adversaire tellement plus nombreux, supérieur en armement et animé d’un grand courage.
L’anéantissement du 3ème BCCP :
Le 3ème BCCP était rentré le 4 ou 5 octobre d’une longue opération au Laos. Pour notre Bataillon, c’était fini, notre séjour était terminé. L’unité qui devait nous remplacer était arrivée et nous devions embarquer sur le Pasteur qui l’avait amenée.
Pourtant nous avons été mis en alerte et les permissions de sortie du 7 au soir ont été supprimées. Le dimanche 8 octobre au matin, nous étions sur le terrain de Bach Mai prêts à sauter.
Il est à noter que pour ce dernier saut, il aurait été possible de ne pas y prendre part. Notre Toubib, le Capitaine Armstrong, était alors très conciliant concernant les exemptions de service. Cependant, rares furent ceux qui en profitèrent.
Depuis son arrivée en Indochine, le 9 novembre 1948, notre cher Bataillon avait vu ses effectifs fondre. Les morts, les blessés et les malades rapatriés sanitaires ont fait que pour ce dernier saut, nous n’étions plus que 285.
Était-ce le réveil tardif d’un instinct guerrier ou l’espoir de décrocher in extrémis quelques bananes valorisantes, quelques-uns de ceux qui n’a avaient pas encore quitté le Protectorat se sont portés volontaires. Quoiqu’il en soit, je me suis retrouvé chef d’un stick ayant un effectif de 8 au lieu des 15 prévus normalement.
Ce n’est que sur le tard que la décision a été prise de nous parachuter. J’ai eu l’impression que l’Etat-Major n’était pas tellement certain de l’absolue nécessité de notre intervention. Néanmoins, le 8 octobre 1950, nous sautions sur That Khé.
That Khé devait être également abandonné. Cette évacuation de la troupe et de la population aurait pu avoir lieu en principe sans trop de problèmes. C’était sans compter un grain de sable qui vint tout remettre en question et devait causer notre perte : le pont, au-delà de That Khé, permettant de franchir la rivière Song Khé Kong, avait été détruit par un commando suicide vietminh.
L’honneur nous avait été fait de former l’arrière garde. La population était déjà partie quand nous avons pris la route. Rien ne semblait plus lugubre que cette ville abandonnée, des foyers allumés par des commerçants qui n’avaient pas pu tout emmener, la fumée, l’éclatement des bambous … Nous n’avions qu’une idée en tête, filer de là !
Nous précédant, les Tabors, avaient conservé un invraisemblable matériel et tout ce qui leur était nécessaire pour leur subsistance hors des villes, y compris les femmes de leur BMC. Leur progression était de ce fait très lente. Arrivés au Song Khé Kong, Il leur fallut évidemment une éternité pour traverser la rivière à l’aide de barques. Quand ils eurent terminé, le jour pointait et pour tout arranger ils avaient laissé les barques en question sur l’autre rive. Il fallut donc que quelques gars dévoués et bons nageurs se mettent à l’eau pour les ramener. Le temps qu’à notre tour nous passions, il faisait grand jour.
Pendant tout ce temps passé à franchir cette foutue rivière, les Viêts avaient eu tout le loisir de nous préparer une magistrale embuscade vers laquelle nous foncions tête baissée.
Le destin du 3ème BCCP se terminait ici, à Déo Cat, tout petit point sur une carte … mais que de sang, que de morts !
Littéralement cloués sur place, nous ne pouvions ni avancer, ni reculer. La seule échappatoire était la brousse à gauche de la route où nous avions tenté de nous dissimuler pour échapper aux tirs. Le fait de n’avoir rien avalé depuis 3 jours n’améliorait pas notre situation.
Au bout d’un certain temps dont je suis bien incapable de déterminer la durée, l’ordre nous fût donné de saboter notre matériel, d’abandonner les blessés et de rejoindre Na Cham en pratiquant la guérilla !!!
Encore un ordre d’une monumentale connerie : non seulement ce message lancé par un Morane 500 signalait aux Viêts notre exacte position mais surtout, comment aurions-nous pu pratiquer la guérilla alors que depuis belle lurette nous n’avions plus de munitions !!!
Le Capitaine Armstrong demeura avec les blessés qui avaient été alignés au bord de la route, puis nous nous sommes enfoncés dans la brousse.
Bientôt nous sommes tombés sur une embuscade, puis une deuxième et encore une autre … Les Viêts avaient investis tous les compartiments du terrain. Ils étaient partout où nous allions, sortant d’une embuscade pour tomber sur une nouvelle !
Lorsqu’on tombe sur une embuscade, on ne reste pas groupé, on éclate, on s’éparpille. À force d’éclater et de s’éparpiller, le Bataillon, ou tout au moins ce qu’il en restait, n’était plus formé que d’une multitude de petits groupes, plus ou moins importants, parfois 2 ou 3 paras, cherchant à tracer une route improbable ver un point salvateur.
Pour ma part, j’errais tantôt seul, tantôt en compagnie d’autres camarades, d’une piste à l’autre, devenu le triste gibier d’implacables chasseurs.
En peu de temps, notre intervention sur That Khé avait viré au cauchemar. Loin d’être décisive, au moins avait-elle permis à quelques rescapés des colonnes Charton et Lepage, environ une centaine, d’échapper à la capture.
Décidée à la hâte, cette opération fut le baroud d’honneur du 3ème BCCP. Était-elle judicieuse ? C’est contestable ! Comment une petite troupe à bout de souffle pouvait-elle redresser une situation compromise dès le départ ? Pour nous et les membres de la compagnie du Lieutenant Loth, la conséquence fut dramatique et causa l’anéantissement du 3ème BCCP.
Si le prix d’une victoire n’est jamais trop élevé, celui d’une défaite l’est toujours trop !
L’enfer de la captivité :
Cette fuite désespérée pris fin le 15 octobre dans l’après-midi en tombant sur deux groupes de partisans Viêts, sans aucune échappatoire.
Vite désarmé, traité correctement, j’ai rejoint un village où déjà quelques-uns des nôtres étaient parqués.
Impression désagréable d’avoir le sentiment que le gros de la troupe était parvenu à s’enfuir et que seuls moi et quelques autres malchanceux avaient été faits aux pattes.
Une ké bat de riz, de l’eau, une cigarette et me voici ficelé, bras dans le dos, lien autour du cou, avec mon chef de corps, le Capitaine Cazaux, allongé dans un fossé.
Toute la nuit, il est tombé des cordes, la pluie rentrant par le col de mon treillis et ressortant par le bas de mon pantalon. J’ai pourtant passé ma première nuit de captif en dormant comme une souche. Il n’en a certainement pas été de même pour le Capitaine Cazaux dont l’unité avait cessé d’exister sans que cela puisse lui être imputé.
Le lendemain matin, le retour à la réalité fût plutôt pénible. J’étais prisonnier et mon avenir était des plus incertain. Rapidement détachés, nous avons été regroupés avec d’autre prisonniers et, l’homme est ainsi fait, la présence d’autres captifs eut soudainement quelque chose de réconfortant car il apparaissait peu probable qu’une telle quantité de prisonniers puisse être liquidée comme ça, discrètement, contrairement à un petit groupe de quelques prisonniers isolés.
Un convoi, d’environ 130 prisonniers dont une dizaine d’officiers, s’est alors formé. Outre le Capitaine Cazaux, je retrouvais le Capitaine Armstrong, le toubib de l’unité, le Lieutenant Rougier, mon supérieur direct ainsi que d’autres officiers et des gars d’autres unités.
En fin de matinée, nous nous sommes mis en route, lestés de notre riz pour le déplacement. Empruntant la RC4, nous sommes repassés à Déo Cat où avait eu lieu l’embuscade fatale. Les morts et les blessés, décédés depuis, étaient toujours allongés sur la route, dépouillés de leurs chaussures et de leurs vêtements. L’odeur était insoutenable. Plus loin, nous avons quitté la route pour emprunter une piste qui serpentait entre les calcaires, cadence supportable, étapes raisonnables, sentinelles compréhensives avec les traînards. Comparativement aux jours précédents, ce trajet fût comme une promenade.
Partis le 16 octobre en direction du nord, notre piste a croisé le 23 octobre une petite rivière. Au niveau du pont, nous avons été séparés de nos officiers auxquels avaient été ajoutés les adjudants et adjudants-chefs. Chaque officier nous a alors serré la main, nous souhaitant bon courage et bonne chance. Ils ont traversé la rivière tandis que nous partions sur une autre piste …nous ne devions pas tous les revoir !
Nous avons fini par atteindre le village de Dong Pan, une petite localité typique de la région avec ses ka nha bâties sur pilotis sous lesquelles trônait l’inévitable buffle et une distribution d’eau de source qu’un judicieux système de dérivations amenait dans chaque foyer.
Nous venions de faire connaissance avec le camp n° 3. Nous y sommes restés jusqu’à la mi-décembre
C’est là qu’avaient été regroupés plusieurs centaines de prisonniers de la RC 4, toutes armes confondues. Des groupes s’étaient formés, par unité, par nationalité pour les légionnaires, tous logés chez l’habitant qui, bon gré mal gré, avait cédé une grande partie de son habitation pour y caser de 20 à 25 prisonniers. Pour eux, ce n’était pas un cadeau car, tous autant que nous sommes, nous étions d’abominables chapardeurs. Ainsi, l’autel des ancêtres qui trônait dans chaque maison et à qui des offrandes alimentaires étaient apportées quotidiennement, avaient rapidement été mis hors de notre portée car en quelques instants les offrandes disparaissaient. Nos rapports avec nos hôtes n’étaient ni bons, ni mauvais, tant qu’ils ont pu nous échanger les rares bricoles échappées aux fouilles, jusqu’à nos chaussures et à nos vêtements. Les rapports étaient même parfois cordiaux … mais du jour où nous n’eûmes plus rien à vendre ou à échanger, l’ambiance changea. Nous n’y pouvions rien, ni les uns, ni les autres, nous étions condamnés à nous supporter !
La nourriture était terriblement insuffisante, composée d’un bol de riz, d’une louche d’un liquide chaud dans lequel surnageait quelques morceaux de liseron d’eau. A ce régime-là, nous ne risquions pas de pouvoir tenir bien longtemps. Si le riz était également leur nourriture de base, les habitants pouvaient néanmoins compléter leur repas avec un peu de viande de volaille, voire du poisson, mais aussi des légumes et des fruits en abondance.
Le soir, regroupés autour d’un maigre feu, nous ne pouvions que maudire notre destin car à cette même heure, nous aurions dû être sur le Pasteur en route pour la France alors que nous croupissions dans un petit village du haut Tonkin pour une durée indéterminée.
Pratiquement jusqu’à la fin du mois d’octobre, les Viêts nous ont fichu une paix royale, à part l’accomplissement des corvées nécessaires. Parfois pendant notre temps libre, un paysan embauchait quelques-uns d’entre nous pour l’aider dans ses tâches quotidiennes avec, en règle générale, quelques nourritures en récompense mais ce n’était pas obligatoire.
Un des principaux sujets de conversation était la possibilité de s’évader, la rêve de tout prisonnier, mais difficilement réalisable. Les lignes française devaient être à 350 kms. Comment parcourir une telle distance sans nourriture, sans boussole et surtout en passant inaperçu ? Le moindre gamin gardant son buffle aurait vite fait de repérer la silhouette d’un européen et de donner l’alerte.
Bien que les chances de réussite soient quasiment nulles, nombreux furent ceux qui tentèrent de faire la belle mais aucune évasion ne réussit. Rapidement repris, les évadés revenaient au camp l’oreille basse. Les plus chanceux s’en tiraient avec une volée de coups, d’autres eurent droit à un séjour plus ou moins prolongé dans la cage à buffle, sous les Ka nha. Cette cohabitation était particulièrement pénible, les pieds dans la boue, dans les excréments et les eaux de cuisine. De plus, ces saloperies de bestioles qui, paraît-il, sont allergiques à notre odeur, tentaient d’écraser l’intrus contre un pilotis. A cela venaient s’ajouter les maringouins, minuscules insectes à la piqûre particulièrement douloureuse. L’enfer tout simplement ! D’autre évadés furent massacrés par des paysans qui avaient été avertis qu’aider un évadé était puni de la peine de mort.
Je n’ai pas tenté l’aventure. A mon avis, il faut avoir un certain pourcentage de chance de réussite pour prendre un tel risque. Un Prisonnier, évadé un soir, l’a compris en revenant de lui-même le surlendemain, affirmant qu’il s’était égaré au cours d’une corvée de bois. Ayant réussi à convaincre les Viêts de sa bonne foi, il eut la chance de ne pas être sanctionné.
Au début du mois de novembre, un nouveau personnage fit soudainement son apparition dans notre univers de captifs : le Commissaire Politique (CP).
Depuis le début de notre captivité, nous étions soumis à l’autorité des chefs de convois lors des déplacements, puis celle du chef de camp une fois arrivés à destination. Ce dernier était surtout responsable de la discipline, des problèmes d’Intendance et des soldats qui nous gardaient. Le CP était un personnage tout puissant, ayant le droit de vie ou de mort sur chaque prisonnier. Rigoureux, intransigeant, communiste convaincu, pour ne pas dire borné, il avait pour mission de nous convertir de gré ou de force, nous abominables mercenaires du colonialisme et des fauteurs de guerre américains, en d’authentiques communistes, combattants de la paix, dévoués corps et âme au service de la cause qu’il défendait.
Notre premier contact eût lieu lors du premier rassemblement de tous les prisonniers présents. Prise de contact plutôt réfrigérante au cours de laquelle il nous déclara, en guise d’entrée en matière, que nous étions des criminels de guerre, méritant tous d’être fusillés sans exception. Son préambule ayant eu l’effet escompté, il modéra alors ses propos en nous disant que le vénérable Président Ho Chi Minh, comprenant que notre jeunesse avait été trompée, souhaitait que nous devenions des hommes nouveaux une fois nos fautes rachetées. Il évoqua ainsi la fameuse « grande clémence de l’oncle Ho » dont nous n’avions pas fini d’entendre parler tout au long de notre captivité. Inutile de dire que la grande clémence en question fit l’objet de bien des railleries, assimilée plutôt à une quelconque chérie qu’à une hypothétique générosité dont nous allions d’ailleurs très vite mesurer les limites.
Puis, pendant plus d’une heure, notre CP nous vanta les mérites du paradis socialiste et voulut, à la fin de son discours, que nous chantions tous en chœur une vibrante Internationale. Ce fut pour lui un bide total ! Nous ne savions pas qu’un jour viendrait où nous chanterions avec lui ou avec tout autre CP, tout ce qu’il voudrait.
Un jour, notre cher CP décida d’interdire les coiffures d’armes. A l’époque, chaque arme portait le calot de différentes couleurs, moi, évidemment le béret rouge. C’est ainsi que le C.P lui-même m’arracha mon béret et le jeta au sol. Habile négociateur, je réussis à lui faire admettre que, sans rien sur la tête en été, nous risquions l’insolation. Il accepta alors mes arguments et me permis de récupérer mon béret à condition de le porter retourné donc côté noir. J’ai donc retourné mon béret pour le conserver, sans pour autant retourner ma veste.
L’effectif du camp était fluctuant, une centaine de prisonniers partaient un beau jour pour une destination inconnue, d’autres arrivaient. Nous retrouvions alors avec joie des copains dont nous ignorions le sort. Avec l’arrivée du CP, la discipline s’était raffermie et les chapardages sévèrement sanctionnés. Les évasions avaient pratiquement cessé bien que le CP ait lui-même proposé cinq jours de vivres à ceux qui voudraient tenter l’expérience. Il n’y eût, bien évidemment, aucun candidat !
Début décembre 1950, une cinquantaine de prisonniers, partirent travailler à la réfection d’une route. Les premiers jours, les outils qui nous avaient été fournis eurent les manches brisés, le lendemain également. Le soir de ce deuxième jour, le bol de riz qui constituait notre ordinaire fût remplacé par un bol d’eau chaude dans lequel flottaient quelques grains de riz. Il en fût de même le lendemain et le surlendemain. Nous fûmes alors ramenés sur le chantier pour y reprendre le travail. Etrangement, à la fin de journée, les manches des outils n’avaient pas été cassés. On avait compris la leçon !
Par petits groupes de 20 à 30 prisonniers, nous avons été envoyés je ne sais où pour quelques travaux, quittant définitivement Dong Pan. Nous avons ainsi été promenés pendant environ un mois de village en village où on nous exhibait. Nous avions fière allure pieds nus avec nos vêtements mal en point, nos barbes hirsutes, les pieds nus qui nous faisait davantage ressembler à des épouvantails qu’à des soldats. Les populations affichaient une indifférente totale, à vrai dire nous aussi, ne pouvant que marcher en silence, profil bas, conscients de notre déchéance.
En janvier 1951, nous avons rejoint le camp n° 2 à Soc Chang, dans le secteur de Trung Khanh Phu. Cette fois-ci, pas de logement chez l’habitant mais des baraquements construits à notre intention et ouverts à tous les vents : une quarantaine de mètres de long sur dix de large, pas de murs, avec à l’intérieur des bats flancs, disposés de chaque côté et destinés au couchage. Il y régnait un froid humide qui glaçait les os.
Le matin très tôt, nous étions rassemblés dans la rizière où le CP venait nous distiller sa bile, après nous avoir fait attendre une heure, parfois plus. Haut comme trois pommes à genoux, il était ridicule avec ses allures de matamore, son casque trop grand et un gros colt qui lui battait la cuisse, une fourragère aux couleurs de la Légion d’honneur pendue à la crosse. Mauvais comme une teigne, il nous promettait les foudres de l’enfer à la moindre incartade puis il regagnait sa baraque après une derrière insulte.
C’est ici que débuta notre endoctrinement politique.
Un matin de février, au rassemblement du matin, nous vîmes qu’un poteau avait été dressé non loin de là. Notre cher CP nous annonça qu’un prisonnier, le caporal Robert Journez, allait être fusillé. Son crime était d’avoir tenté d’entrer en contact avec les Français alors qu’il était affecté à la réparation de postes radio. Une mitrailleuse, d’une rafale, coupa en deux ce valeureux garçon devant nous, tous figés dans un impeccable garde à vous.
Quelques temps plus tard, un nouveau CP nous fût affecté, bien différent de notre nain de jardin. Relativement sympathique, parlant un français parfait, c’est tout juste s’il ne nous traitait pas en copains. Lors d’une réunion, il nous annonça qu’il avait décidé que les prisonniers devaient écrire un journal et demanda des volontaires. Je fus du nombre, non pas que j’eus quelques prétentions épistolaires mais, qui dit journal dit papier, et le papier. Or, le papier était un matériel précieux, indispensable pour rouler des cigarettes avec les rares feuilles de tabac que nous arrivions à faucher sur un pied puis à faire sécher sur une tôle. Il vous arrachait la gueule !
Mon copain Claude Bergerat était également volontaire, ainsi qu’un autre grand copain Dubus, volontaire d’office. Ce malheureux Dubus avait, parmi les prisonniers, une place peu enviable. Ayant fait ses études à Hanoï, il parlait et lisait le vietnamien, or le CP exigeait que leurs conversations aient lieu en vietnamien. De ce fait, les autres prisonniers, ne comprenant pas ce qu’il disait exactement, avaient tendance à douter de ce pauvre Dubus. Un autre volontaire, Karakach, copiste et dessinateur doté d’un remarquable coup de crayon, était chargé de l’illustration.
Nous avons ainsi pondu notre premier journal. Pour ma part, j’avais écrit un petit article sur les bobards inévitables qui abondaient. Il y avait même une grille de mots croisés. Nous avions trouvé un titre original : “La Gazette du Prisonnier“ et vogue la galère. Notre premier numéro n’eut pas l’air de plaire à notre CP qui se mit dans une colère noire. Il est vrai que notre journal ne faisait aucunement mention de politique, se focalisant sur la vie du camp, les fêtes passées au loin et autres fariboles. Il voulait des textes reflétant notre adhésion, pleine et entière, à la lutte pour la paix au Viêtnam, et stigmatisant les fauteurs de guerre américains et autres colonialistes et impérialistes de tout poil.
Notre journal mural n’eut qu’un seul exemplaire et perdura jusqu’au départ du premier convoi. Chaque semaine, le CP réunissait son équipe de plumitifs pour fixer les thèmes à aborder et nous vanter les joies sans nombre dont bénéficiaient les heureux élus qui vivaient en Russie et dans les autres pays amis ; joies que nous connaîtrions un jour quand, grâce à lui, nous serions devenus des hommes nouveaux.
Nous avions mis un doigt dans l’engrenage, impossible désormais de faire marche arrière. Puis vint l’époque des manifestes, des résolutions, des proclamations et autres billevesées ; des écrits dont parfois la roublardise échappait à nos geôliers.
À quelques temps de là, notre CP, toujours très actif, décida de nous confier la rédaction d’un appel au Président Ho Chi Minh, toujours aussi vénérable, pour lui demander notre libération. Ce fût Bergerat qui se chargea de rédiger ce fameux appel. Il pondit un texte tout en finesse que j’aurai aimé pouvoir conserver, répondant à la fois aux attentes du CP, sans trop se compromettre pour autant.
Il s’agissait maintenant de faire signer cet appel par tous les prisonniers … sans exception. Ce fût laborieux, certains prenant cette signature comme un engagement. Il fallut une semaine entière pour que tous signent. Ce qui n’empêcha pas les Viêts d’envoyer en camp disciplinaire les 50 derniers signataires.
Parmi les Européens se trouvait un Allemand du nom de Borchers. Il s’était engagé à la Légion uniquement pour déserter. Lorsque je l’ai rencontré, il avait le grade de Colonel et avait pris le nom de Chien S’y, ce qui signifie le combattant. Il était assez sympa avec les Prisonniers et obtenait souvent pour eux une demi-journée de repos ou quelques améliorations alimentaires. À la fin de la guerre, les Viets l’ont viré. Il a fini ses jours à la radio Est Allemande.
Dans ce camp, en complément de notre éveil à l’idéologie communiste, nous donnions souvent un coup de main aux paysans pour leur récolte du riz, travail absolument exténuant, hors de notre portée. Il faut être né ici pour avoir l’échine assez souple. Quelques nourritures récompensaient parfois nos efforts mais notre rendement était si faible que les paysans finirent par renoncer rapidement à nous employer.
Début mars, le printemps s’annonçait et le ciel devint plus clément. Nous avons alors quitté sans regrets nos baraquements ouverts aux quatre vents avec l’espoir d’être mieux logés.
Nous nous sommes ainsi retrouvés à travailler sur la route allant de Quang Uyen à Ta lung. A la suite du passage répété des camions russes qui empruntaient nuitamment cette route, de nombreux virages s’étaient effondrés. Notre mission consistait à redresser ces virages : plus haut sur le calcaire, certains faisaient dégringoler de gros blocs de pierre, d’autres étaient alors chargés d’en réduire la taille, avant que d’autres enfin ne les transportent sur les lieux d’utilisation. Ces travaux étaient d’autant plus épuisants pour des organismes sous alimentés qu’ils étaient effectués en plein soleil de 8h00 du matin à 18h00, 6 jours sur 7, le dimanche étant consacré à la chasse à la vermine qui nous envahissait, sans oublier l’éducation politique omniprésente au quotidien.
Et pourtant, nous travaillions tous au maximum de nos possibilités car avant que ne commencent ces travaux routiers, le CP nous avait annoncé la création de “comités de Paix et de rapatriement”.
“Rapatriement” était pour nous un mot magique, rempli d’espoir, qui ranimait toutes les énergies même les plus défaillantes. Nous nous sentions abandonnés et n’avions plus rien à quoi nous raccrocher en dehors de cette faible lueur d’espoir. Des efforts surhumains ont ainsi été fournis par des prisonniers incapables de suivre la cadence et qui s’obstinaient, malgré tout, pour ne pas perdre leur chance d’être rapatriés. Beaucoup y consumèrent leurs dernières forces !
Le nombre de décès qui avait très sensiblement baissé pendant l’hiver remonta alors en flèche, tant et si bien que le travail fût légèrement allégé avec un repos les samedis et dimanches et un horaire de travail de 9h00 à 17h00.
Nous nous déplacions le long de la route au fur et à mesure des travaux. Un jour, nous avons atteint le village de Long Co, remarquable par le fait que le point d’eau se trouvait au fond d’un gouffre d’une vingtaine de mètres, rendant alors la corvée d’eau particulièrement acrobatique.
Fin avril-début mai, nous sommes finalement arrivés au KM 10 de cette route, dans le village de Fia Khéo. Ce village se trouvait au pied d’un calcaire sur lequel s’ouvrait, à mi-pente, une vaste grotte. Nous y sommes restés assez longtemps.
Les travaux routiers se sont alors interrompus pour céder la place à une éducation politique à haute dose.
Sur un terrain voisin avait été fabriquée une petite estrade et toute une série de bancs disposés en rond. Après y avoir pris place, notre infatigable CP commençait alors ses cours. Le plus merveilleux dans la dialectique communiste est sa capacité, avec un vocabulaire réduit, à répéter toujours les mêmes mots, les mêmes phrases, cent fois, mille fois. C’est assez lénifiant ! Mais pas question pour autant de somnoler ou de laisser son esprit vagabonder ; les visages étaient scrutés, des questions posées et malheur à celui qui ne répondait pas correctement à une question de l’orateur.
Après la pause destinée au festin de midi, la séance reprenait l’après-midi avec les mêmes formules, le même bourrage de crâne, à raison de 6 jours par semaine, des semaines durant, c’est abrutissant !
L’idée précédente du CP concernant le journal fut reprise avec l’équipe habituelle. Nous fûmes donc chargés, Bergerat, Karakach et moi, de sa parution une fois par semaine.
Nous avions désormais parfaitement saisi la teneur que devaient avoir nos articles … Notre CP était aux anges.
Les premières libérations :
Le 10 juin, lors du rassemblement du matin, un événement majeur se déroula : une centaine de noms furent appelés et mis à l’écart. Après quoi, notre cher CP nous annonça que ces appelés allaient former un convoi. Ils étaient libérés et prendraient aussitôt le chemin des lignes françaises. Moments de joie pour les partants, période d’abattement pour ceux qui restaient.
Après des adieux mêlés d’envie, des adresses échangées et des messages confiés, le convoi se forma et disparu bientôt au premier virage.
L’atmosphère était plutôt morose. Toutefois, ce départ soudain avait frappé bien des esprits mais surtout avait ranimé l’espoir d’une libération anticipée qui sommeillait en chacun de nous. Les promesses dont les Viêts nous berçaient depuis si longtemps avaient été suivies d’effet. Des libérations venaient d’avoir lieu, d’autres suivraient ! Il fallait donc continuer d’espérer, de travailler, de suivre avec une attention soutenue ces foutues séances d’éducation politique. Un jour viendrait alors où un autre convoi de prisonniers prendrait la route de la liberté.
Pendant les semaines qui suivirent, tous les prisonniers eurent une conduite exemplaire, plus de tire au flanc, plus de mauvaise volonté, un rendement constant, des élèves attentifs, plus de traînards.
Mes amis Dubus, Bergerat et Karakach étant partis, je restais le seul de l’ancienne équipe. Je fus alors rejoint par un légionnaire allemand faisant office de traducteur, car ce fameux journal avait une édition en allemand, par un autre copiste car mon écriture était désastreuse et par un nouveau dessinateur. Nous voilà donc repartis avec des articles tellement politisés qu’ils auraient pu être écrits par le plus communisant des journalistes.
Fier de son œuvre, le CP nous octroyait de temps à autre quelques faveurs : distribution de tabac, de fruits, quelques grammes de viande. Quel changement !
Le 10 août, lors de l’appel du matin, soit très exactement 2 mois après la précédente libération, environ 80 nouveaux prisonniers furent appelés pour être libérés. En revanche, ce jour-là, pas d’adieux chaleureux. A peine nommés, les heureux désignés prirent la route, sans aucun contact, ni échange. Ils n’étaient pas partis, ils s’étaient tout simplement enfuis !
Pour ceux qui restaient, le moral était au triple zéro car ils s’étaient bien rendu compte que les partants étaient tous dans une forme suffisamment bonne pour effectuer une longue marche jusqu’aux lignes françaises. A vrai dire, parmi les laissés pour compte, peu en définitive aurait été capable de s’attaquer à une telle épreuve. Hélas, J’étais du nombre, une récente crise de paludisme m’avait mis à plat.
Au KM 10, le village de Fia Khéo ne comportait que quelques maisons. Le CP, le chef de camp et les sentinelles y étaient logés. Aux alentours immédiats se trouvaient d’autres groupes de maisons abritant les prisonniers. Aux heures des repas, nous nous réunissions au village pour percevoir notre éternelle ration de riz, notre menu quotidien.
La tragédie du 15 et 16 août 1951 :
Le 15 août, ayant comme à l’accoutumé somptueusement dîné, je regagnais la maison où je logeais à environ 300 m du village, de l’autre côté de la rizière. J’étais à peine rentré que des avions sont apparus et sont mis soudainement à mitrailler Fia Khéo. D’où j’étais, je les voyais piquer, mitrailler, remonter puis mitrailler à nouveau. Au bout de quelques minutes, ils sont repartis. Je n’ai pas été autorisé à quitter ma maison pour aller aux nouvelles et ce n’est que le lendemain que j’ai pu constater l’étendue des dégâts : une maison brûlait encore, d’autres avaient été éventrées, les victimes étaient surtout des paysans et quelques sentinelles, le CP avait été épargné … dommage !
Nous ne parvenions pas à comprendre les raisons de ce raid meurtrier car il n’y avait aucun objectif militaire dans la région. Ce petit village isolé ne pouvait en aucun cas constituer une cible valable.
Le lendemain, alors que la distribution de riz du soir était à peine commencée, les avions sont revenus, 4 cette fois-ci, soit le double de la veille. Les mitraillages et les bombardements ont alors repris, les avions effectuant plusieurs passages.
Réunis dans la même frayeur, paysans et prisonniers s’étaient rués pour chercher un abri dans la grotte qui surplombait le village. Une bombe était tombée à l’entrée, provoquant un éboulement qui fit beaucoup de victimes. Les avions ont aussi mitraillé les malades logés dans un pagodon de l’autre côté de la route et ceux qui tentaient de s’enfuir à travers les champs de maïs. Ce fut une véritable boucherie. Puis ils sont repartis … nul doute qu’une paire d’heures plus tard, les pilotes et les mitrailleurs, attablés devant un verre à Hanoï, se féliciteraient du travail accompli !!!
Pour nous, prisonniers, c’était le chaos. Plusieurs prisonniers avaient été tués et les blessés se comptaient par dizaines. Ces derniers devaient à peu près tous mourir de leurs blessures, faute du moindre soin. Trente des nôtres venaient de mourir sans que nous ne parvenions à comprendre pourquoi quatre de nos avions s’étaient livrés à un tel massacre sans la moindre raison tactique.
Notre CP, une fois remis de ses émotions, jubilait. Quel bel argument de propagande lui procurait ce bombardement ! Selon lui, nous avions été attaqués parce que le gouvernement français savait désormais que nous n’étions plus d’affreux mercenaires à la solde des Américains mais, au contraire, d’authentiques combattants de la Paix, éveillés désormais au monde socialiste. Argument imparable qui fit l’objet d’un tract virulent dont je possède un exemplaire rarissime.
Les jours suivant furent abominables. Les survivants, réfugiés au-delà de la rizière, abandonnés à eux même, erraient comme assommés par le sort. Les cuisiniers faisaient cuire le riz de la journée très tôt le matin, avant le lever du soleil, nous obligeant à percevoir notre bol de riz du midi et celui du soir en même temps. Il était risqué d’en conserver la moitié jusqu’au soir, de crainte qu’il ne moisisse. Tout manger était la solution mais nous n’avions alors plus rien à manger avant le lendemain matin.
Pour tout arranger, la pluie s’était mise à tomber sans discontinuer. Tout rassemblement étant interdit jusqu’à nouvel ordre, nous étions dispersés dans la nature, abrités plus mal que bien sous des arbres épais ou des rochers. Nous avons ainsi vécu un période épouvantable.
En route vers le camp n° 5 :
Les Viêts, complètement dépassés, ne savaient plus quoi faire. Ils attendaient des instructions qui furent longues à venir. Une bonne semaine après ces tragiques événements, la décision tomba enfin de reprendre la piste. Celle-ci, qui serpentait entre les calcaires, fût un véritable chemin de croix. Aidant au mieux les blessés et les malades, nous marchions le ventre vide, trempés et gelés. De ce fait, la colonne progressait lentement, très lentement. Les sentinelles se montrèrent très compréhensives, raccourcissant aux besoins les étapes. Nous couchions là où nous nous étions arrêtés, sous quelques baraquements souvent délabrés lorsque cela était possible.
Chaque matin, nous faisions le décompte des morts de la nuit. Ces malheureux, après avoir luttés tant et plus, étaient parvenus au bout ultime d’une résistance qu’aucun être humain ne peut dépasser. Pauvres compagnons ayant survécus à tant de misère, ils avaient fini par lâcher la rampe, doucement sans souffrance ! Bien que le spectacle quotidien de la mort nous ait tous endurcis, le départ de chacun d’entre eux fut une épreuve.
Nous avons ainsi marché de longues semaines, d’un village à un autre, un peu comme s’ils voulaient nous déboussoler. Nous sommes finalement arrivés à destination sans que je puisse localiser exactement où nous nous trouvions. Il faut dire que lors de nos différentes étapes, il était difficile de connaitre le nom des villages traversés ; vouloir s’en informer aurait été considéré par nos hôtes comme de l’espionnage.
Ce qui est certain, c’est qu’en octobre, nous étions dans un village du nom de Na Leng. Ce nouvel emplacement, le camp n° 5, ne signifiait pas pour autant la fin de nos maux. D’autres prisonniers, guère en meilleur état, tentaient d’y survivre. Ils avaient connu comme nous des libérations, quelques temps auparavant et étaient aussi démoralisés que nous.
J’eus néanmoins une énorme surprise à l’arrivée au camp n° 5 en y retrouvant mes amis Dubus, Bergerat et Karakach. Je les croyais de retour en France depuis bien longtemps alors qu’ils étaient toujours là : lors du départ du 1er convoi, les Viêts les avaient amenés à proximité des lignes Françaises puis ramenés en arrière. Le 2ème convoi avait bénéficié de la même mise en scène. Quelle cruelle comédie ! Avoir été à deux doigts de la liberté et être encore captif, pourquoi tant de cruauté ?
Au début, pas de travaux à l’horizon et éducation politique en veilleuse. Nous commencions doucement à récupérer, à sortir de la torpeur dans laquelle nous avait plongé les raids incompréhensibles de nos propres avions … Tous nos copains massacrés ensevelis sous quelques centimètres de terre au bas d’un piton !
Petit à petit, nous avons fini par retrouver le rythme que nous connaissions au camp n° 3 : moins de travaux mais formation politique à haute dose par un continuel bourrage de crâne qui faisait désormais partie de notre quotidien, 3h00 du matin, 4h00 de l’après-midi. Les mêmes mots et formules répétés en permanence finissaient par créer une sorte de rejet. Je suis certain qu’un gars qui aurait eu quelques tendances communisantes aurait fini par les rejeter, comme un gars que l’on aurait gavé de sucreries afin de vouloir en faire un futur vendeur de confiseries. Progressivement, nous finissions par nous désintéresser de tout, il fallait marcher, nous marchions, il fallait chanter, nous chantions, il fallait fermer sa gueule, nous nous taisions, il fallait obéir, nous obéissions tels des robots déshumanisés. A cette époque nul ne pensait à l’avenir.
Enfin libre !
C’est de ce village qu’est parti le 18 novembre 1951 le 3ème convoi de libérales. J’en faisais partie, ainsi que Bergerat et Karakach. Malheureusement, Dubus, mon grand ami n’était pas du voyage car les Viêts s’entêtaient à le garder prisonnier. Pourquoi faire du camp, subir les séances d’endoctrinement, si on retenait un libérable ? Au moment de partir, il ne restait d’ailleurs au camp que quelques disciplinaires et moribonds. Lorsque j’ai dû le quitter et que le convoi a pris la route, ce fût pour moi un véritable crève-cœur d’abandonner un compagnon de captivité qui m’était aussi cher, d’autant que j’étais persuadé de ne plus jamais le revoir. J’ai juré mes grands Dieux à ses parents, venus me voir à la citadelle à Hanoï, qu’il s’en sortirait, sans vraiment y croire. Pourtant en juin suivant, il fût libéré et j’eus alors la joie de le retrouver. Comment était-il parvenu à résister aussi longtemps, seul, abandonné de tous ? je lui tire mon chapeau !
Lors des convois précédents, les libérés prenaient directement la route de la liberté. Pour le 3ème convoi, ce fût différent. Nous avons tout d’abord été regroupés avec les libérés d’autres camps pour subir encore plusieurs semaines d’endoctrinement. Alors que nous avions jusqu’à présent échappé à la gale, ce contact avec d’autres prisonniers eut pour conséquence directe de nous contaminés. Nous étions à notre tour tous galeux, quelle joie !
Nous nous sommes mis en route aux alentours du 15 décembre. Au cours de cette longue marche, nous avons aidé et soutenu du mieux que nous pouvions ceux qui avaient du mal à suivre. Malheureusement, nous avons dû abandonner deux copains, incapables de continuer. Il nous était devenu possible de les assister davantage, sans aller au-delà de nos propres forces. Je n’ose penser à ce qu’ils ont dû ressentir, voyant partir le convoi.
La fin de cette maudite année 1951 arrivait et nous n’étions plus désormais bien loin de la fin de notre calvaire. Finis les cheminements nocturnes par crainte des avions, tellement plus pénibles pour nos pieds nus souffrant sur les cailloux, les racines et autres et autres petits obstacles douloureux. Nos uniformes, réduits à l’état de haillons, furent alors remplacés par la tenue des paysans locaux, un pantalon et une veste en toile du plus beau vert.
Dans chacun des villages où nous nous arrêtions pour passer la nuit, nous étions accueillis par un petit comité de femmes qui, manifestement auraient préféré être ailleurs. L’une d’elles prononçait quelques mots qu’aussitôt notre CP traduisait en un long exposé sur ses thèmes favoris.
Nous sommes enfin parvenus en 1952, mettant un terme à cette année noire, cette année tragique que fut 1951.
Le 9 janvier, après un repas vraiment amélioré, notre fidèle CP nous fit ses adieux. C’est tout juste s’il n’avait pas des larmes dans la voix, nous disant combien il était fier de nous, constatant que nous étions désormais devenus d’ardents combattants de la Paix, ayant fait de sa cause la nôtre. Comme nous étions loin de ces mois de lavage de cerveau, notre liberté était toute proche, cela seule comptait
Le 9 au soir, après une journée de repos, nous sommes partis de nuit et en silence afin d’éviter d’éventuelles patrouilles françaises, parcourant ainsi nos derniers kilomètres de prisonniers.
Au petit matin du 10, alors que le ciel commençait à blanchir, nous avons rejoint une petite route macadamisée. Là, le chef des sentinelles qui nous escortaient nous a indiqué la direction du poste français le plus proche, puis tous ont disparu.
Nous avons patiemment attendus que le jour se lève afin de ne pas courir le risque de se faire allumer par une sentinelle un peu trop nerveuse. Quand il fit grand jour, nous nous sommes mis en route et, au détour d’un virage, nous avons aperçu le poste et notre drapeau qui flottait au vent. Soudain, nos 455 jours de captivité n’étaient plus qu’un douloureux souvenir, nous étions libres !
Vous imaginez ce que furent ces instants de liberté retrouvée : accueil chaleureux entre tous, le premier quart de café, même militaire, le premier morceau de pain, la première cigarette … comme tout était merveilleux !
Retour à Hanoï :
Des camions sont vite venus nous récupérer pour nous amener à la citadelle d’Hanoï. Rapidement débarrassés nous fringues pleines de vermines, lavés, décrassés, nous fument soigneusement badigeonnés d’alcool iodée afin de nous débarrasser de notre gale, traitement de cheval particulièrement douloureux aux endroits sensibles mais très efficace. Nous étions des hommes neufs.
De charmantes AFAT sont venus nous distribuer de menus cadeaux, rasoirs, savons, serviettes, brosses à dents et surtout de quoi nous permettre d’envoyer quelques mots à nos familles. Nous eûmes également droit à un solide repas mais limité cependant, 15 mois de disette ayant passablement détraqué nos organes.
Enfin, nous reçûmes quelque argent de nos soldes en retard. A cette occasion, l’administration militaire fit un geste d’une rare élégance : l’argent dédié à notre propre nourriture avait était retenu pendant la captivité, sous prétexte de nourrir les prisonniers viêts. C’était tout simplement révoltant.
Une AFAT que j’avais rencontrée avant mon départ pour le saut fatal, ayant appris que je figurais au nombre des libérés, me fit passer un mot pour que je la retrouve le soir même dans un restaurant près du petit lac.
Bien que nous ayons perçu de nouvelles tenues, mesurant 1m 95, mon pantalon m’arrivait à mi-mollet. Quant aux chaussures, impossible d’en trouver à ma taille. Avant ma captivité, je chaussais déjà un bon 45 et les mois de marche pieds nus m’avaient considérablement élargi le pied. J’étais devenu “inchaussable”. Je me suis donc présenté pieds nus au poste de garde. Au départ, le chef de poste prit assez mal la chose mais après moult négociations, je parvins à le convaincre de me laisser aller jusqu’à un magasin d’articles de sport pas trop éloigné où je dénichai effectivement une paire de baskets, pointure 48.
Mon statut de prisonnier libéré le matin même l’avait vraisemblablement emporté et je pus aller dîner en ville.
Mon nom figurant en tête de liste des prisonniers arrivés à la citadelle, je pus prendre place à bord d’un JU 52 qui, dès le lendemain, me déposait au Centre de repos de Nha Trang.
Il faut avouer que l’armée avait bien fait les choses : des bâtiments face mer, une plage de sable fin même si en janvier, ce n’était pas l’idéal, un logement correct et 5 repas par jour (petit déjeuner, casse-croûte à 10h00, déjeuner, goûter et repas du soir). Par ailleurs, il y avait toujours la possibilité de prendre un cyclo pour aller casser la croute en ville. sur place, j’étais même parvenu à me faire confectionner une paire de chaussures à ma taille chez le maitre bottier.
J’ai vite été rejoint par le gros du convoi et durant un mois nous avons vécu une période de rêve : location de vélos ou de petites motos pour visiter les environs, cinéma, danse au foyer de la Légion … en un mot « la vie de château … pourvu que ça dure ! ». Malheureusement, ça n’a duré qu’un mois, pas un jour de plus. Une place étant disponible dans un DC8 pour Saïgon, me voilà reparti, bien à regret.
Je n’avais séjourné à Saigon que quelques jours en novembre 1948, ville trépidante, colorée bien loin d’Hanoi la provinciale. Mon séjour fut d’assez courte durée car le Pasteur, redescendant d’Haiphong, était attendu.
Retour en France :
J’aurai bien évidemment préféré rentrer en France avec tous mes compagnons d’infortune mais ils étaient toujours à Nha Trang. Je rentrai donc en solitaire.
Le 9 mars 1952, au petit matin, je débarquais à Marseille… Un débarquement presque clandestin, au son d’une musique militaire anémique, avec pour tout réconfort une distribution de café froid et de croissants rassis. Transporté en camion vers le camp Sainte Marthe pour y effectuer mes formalités administratives, à 20 heures j’étais à la gare St Charles pour prendre le train de nuit.
Arrivé tôt le matin en gare de Lyon, je redécouvrais Paris le 10 mars. Je prenais un taxi qui me déposait d’où j’étais parti pour courir l’aventure 4 ans plus tôt.
Pendant ma permission de 4 mois, j’étais allé à St Brieuc où le 6ème bataillon de parachutistes coloniaux (BPC) était en instance de départ pour l’Indochine. J’avais été reçu par le chef de corps, le Commandant Bigeard, qui avait commandé le GC 2 du 3ème BCCP et au sein duquel j’avais servi de février 1948 jusqu’à son anéantissement sur la RC4 le 9 octobre 1950. Il se faisait fort de me récupérer dès mon réengagement.
Songeant sérieusement à rempiler, je me suis donc présenté au bureau de recrutement 71, rue Saint Dominique où je m’étais engagé en février 1948. On me répondit qu’étant un ancien prisonnier, je ne pouvais pas retourner en Indochine.
J’appris par la suite que c’était faux car plusieurs de mes copains, dans la même situation que moi, étaient repartis. Ainsi, l’un de mes camarades de captivité, un nommé Larquois, avait été capturé une seconde fois après Dien Bien Phu. Ayant repéré un ancien CP, inutile de dire qu’il n’avait pas donné son nom et qu’il se faisait tout. Il est vrai qu’avec mon mètre 95, il m’aurait sans doute été difficile de passer inaperçu !!!
N’en sachant rien alors et n’ayant aucune envie de me retrouver en AOF, en AEF, à Madagascar ou bien encore en Allemagne avec les forces d’occupation, je préférais renoncer et j’ai ainsi quitté définitivement l’armée, en conservant le meilleur souvenir malgré le douloureux épisode de la captivité.
J’avais 23 ans et mille souvenirs de cette vie passée, désormais terminée. Je devais maintenant me réhabituer à la vie civile et me construire un avenir. Cela ne fut pas évident car pour trouver un emploi, il eut mieux valu que j’avise mes employeurs en puissance que j’étais un repris de justice plutôt qu’un ancien d’Indochine. Automatiquement, un entretien d’embauche bien commencé prenait fin sur la promesse d’un prochain courrier qui aurait été négatif si on s’était donné la peine de l’envoyer.
Je parvins néanmoins à trouver un emploi grâce à la recommandation de la mère d’un officier prisonnier.
Les déserteurs étaient nombreux, là-bas, on les appelait des ralliés, quelques-uns devinrent des combattants et nous avons parfois eu affaire à eux, les autres végétaient sans guère de considération.
Mariés et ayant fondé famille, ils furent également expulsés, les Allemands rapatriés, les Français ne furent guère poursuivis. Imaginez-vous que lorsqu’une loi attribua aux anciens prisonniers une pension d’invalidité en fonction de leur état de santé, certains d’entre eux osèrent se présenter pour en bénéficier, il faut le faire, ils furent évidemment déboutés.
En dépit de tout cela, bien que ces années passées sous l’uniforme aient été parfois tragiques et que le recul du temps embellit souvent les situations douloureuses, j’ai la certitude que si c’était à refaire, je repartirai avec le même enthousiasme et la même foi.

Views: 379
Robert Schuermans : Itinéraire d’un para du 3ème BCCP en Indochine Lire la suite »
Parcours de Daniel Guidé, témoin et survivant des deux grands totalitarismes du XXe siècle, par Mickael Guide, son petit fils.

Daniel Guidé, matricule 44064 à Dora, ancien caporal-infirmier du 8e BPC parachuté à Diên Biên Phu, est l’un des rares Français à avoir traversé, et survécu, aux deux enfers du siècle : les camps de concentration nazis et les camps communistes du Vietminh. Son destin individuel, tragique et exemplaire, s’inscrit dans l’Histoire tourmentée d’une époque où l’humanité sombrait régulièrement dans l’abîme.
Un jeune homme dans la tourmente
Né le 27 mars 1921 à Paris, dans le 10e arrondissement, Daniel Guidé est le fils d’André-René Guidé et de Geneviève Hélène Boulanger. Son enfance est marquée par la précarité : son père décède jeune, sa mère vit en concubinage, et le jeune Daniel cherche sa voie entre le théâtre, le piano et des cours pour intégrer une troupe de music-hall.
Mais l’Occupation vient bouleverser cette trajectoire. En décembre 1940, il signe un contrat de travail avec une entreprise française qui l’envoie en Allemagne, à Pinnebergbei Hamburg, où il manie la pelle et la pioche pour Christian Oelting. Il travaille ensuite sur les chantiers de Tegel et de Tempelhof, participant à la construction d’aéroports pour le IIIe Reich contre son gré et avec un salaire de misère et des conditions proches de l’esclavage.
Lorsqu’il tente de s’évader avec un camarade français, après avoir traversé une partie de l’Allemagne, il est arrêté, emprisonné à Fulda, puis s’échappe lors d’un transfert. Repris à Metz — alors annexée — il subit plusieurs semaines de détention avant d’être relâché. Il rejoint la Bretagne, dans la région de Vannes, et s’engage le 1er novembre 1942 dans l’Armée des Volontaires, service action, (SR-AV) petit réseau de la Résistance intérieure proche de l’Action Française (cf. Archives de Vincennes, dossier Daniel Guidé GR16P276717), mais doit fuir fin 1943 après une vague d’arrestations qui décime le mouvement.
Le 5 janvier 1944, alors qu’il tente de franchir la frontière espagnole pour rejoindre les Forces Françaises Libres en Afrique du Nord, il est arrêté dans un train par les autorités allemandes. Interrogé et torturé à Perpignan par la Gestapo(nous avons obtenu les papiers de preuve de l’interrogatoire), il est ensuite transféré au camp de Compiègne-Royallieu, matricule 25528. Les conditions de vie de ce frontstalag 122 sont déplorables, avec promiscuité, froid, nourriture rare et mauvaise.

Le 27 janvier 1944, Daniel Guidé est déporté à Buchenwald dans le convoi I.173, avec 1 584 prisonniers, dont 1 414 Français, connu sous le nom de convoi des 1500. D’après les sources, ils partent au son du chant de la marseillaise. Un tiers seulement survivront (34% de survie), dont Daniel Guidé et d’autres comme Jorge Semprun . À son arrivée, il est déshabillé, rasé, désinfecté, et numéroté 44064. Il se déclare serrurier, une ruse courante pour éviter les kommandos les plus meurtriers.
Le 13 mars 1944, il n’évitera pas la plus grande peur des déportés de Buchenwald, il est affecté à Dora-Mittelbau, surnommé « l’enfer de Dora » cœur souterrain de l’industrie d’armement nazie où l’on assemble les fusées V2 sous la direction du SS Kammler et de Wernher von Braun, qui donnera les missiles balistiques et la Lune à la NASA et aux américains. Là, dans un tunnel gigantesque creusé à même la montagne, il partage l’existence spectrale de milliers d’hommes que les nazis déshumanisent méthodiquement. Il vit dans le Block 6, ne voit jamais la lumière du jour, respire une poussière corrosive, partage son sommeil avec les cadavres dans des tunnels transversaux. Le taux de mortalité est terrifiant, et on compte en moyenne 80 morts par jours en cet hiver 1944. L’espérance de survie d’un déporté à cette époque du tunnel est estimée à 6 semaines !
Plus tard, une fois les logements extérieurs enfin construits fin avril 1944, il est affecté au Block 115, au kommando le plus redouté : la Transportkolonne, sous les ordres du « gorille »(cf Yves béon) , kapo allemand sadique et meurtrier. Il y croise Bertin Azimont, puis Michel Bedel et Serge Besse dans les kommandos Askania et Bauwe
De la marche de la mort à la libération
Le 4 avril 1945, alors que les Alliés approchent, les SS évacuent le camp dans la panique. Commence alors la marche de la mort, prélude à une agonie qui se prolonge jusqu’à Bergen-Belsen. Dans des wagons découverts, sans eau ni nourriture, les déportés agonisent pendant des jours, en étant trimbalés sans but suivant les bombardements alliés. S’
Daniel Guidé arrive le 9 avril dans ce camp déjà saturé, livré au chaos. Jusqu’à l’arrivée des Britanniques le 15 avril, les détenus n’ont aucun soin, aucune nourriture. Même après la libération, les morts se comptent encore par milliers, victimes du typhus et de la malnutrition. Daniel est rapatrié par camions militaires, via Solingen, Bruxelles et Lille, avant de rejoindre le centre du Lutetia à Paris le 30 avril 1945.
Il ne reverra pas sa mère, décédée en 1943.

Un second cauchemar : la guerre d’Indochine
Démobilisé de l’Armée des Volontaires et donc des FFI en janvier 1946, par décret 366 du gouvernement provisoire de la République, il s’engage de nouveau dans l’armée, au 1er Régiment de Chasseurs Parachutistes dès février 1946. Entre 1946 et 1953, il est envoyé en Algérie, Tunisie, Italie, puis passe par divers régiments et bataillons de parachutistes. En 1948, il épouse Jeanne Pallenti, d’origine corse. Trois enfants naîtront : Patrice, Daniel (mon père) et Christian.
Le 31 juillet 1953, il embarque pour l’Indochine. Il intègre le 8e Bataillon de Choc, troupe d’élite parachutiste, sous les ordres du capitaine Touret et saute dans la cuvette de DiênBiên Phu le 21 novembre 1953. Blessé une première fois puis réaffecté 10 jours plus tard, il participe à toute la bataille — la plus terrible de la guerre d’Indochine — et survit là encore, malgré des combats acharnés, des blessures, une défense désespérée. Il est notamment cité pour la bataille des 5 collines, puis pour les combats sur eliane 2, dominique 2, hug
Il est cité à l’ordre du bataillon, décoré de la Croix des Théâtres d’Opérations Extérieures et de la Médaille militaire avec palme. William Schilardi, mitrailleur du 8e Choc, se souvient encore de lui en 2025, comme d’un « caporal infirmier courageux et dévoué , qui l’a soigné au moins une fois».
Encore une marche de la mort
Le 7 mai 1954, après la reddition, 11 000 soldats français entament une nouvelle marche de la mort à travers la jungle. Blessé, comme 4000 d’entre eux, Daniel Guidé parcourt 700 km à pied dans la jungle vers les camps de rééducation du Vietminh : Camp 70, et d’autres, encore plus reculés. Il subit propagande, carences, isolement. Il est libéré le 31 août, rapatrié en octobre 1954. Il fait partie des 3 300 survivants sur 11 000 prisonniers : 70 % de mortalité.
Un homme de son siècle
Usé physiquement, marqué dans sa chair et son esprit, Daniel Guidé est radié de l’armée en 1956. Il se sépare de Jeanne sans divorcer, aura d’autres enfants qu’il reconnaît. Il vit entre Toulouse, Pau, Paris, où il termine sa vie comme pompiste. Il décède en 1972, enterré au cimetière de Thiais. Il laisse derrière lui des poèmes, plusieurs consacrés à ses années de déportation.
Un témoin de l’abîme
Mon grand-père aura connu les deux grandes formes de l’enfer concentrationnaire du XXe siècle : les camps d’extermination par le travail du national-socialisme et les camps de rééducation communiste du Vietminh. De Buchenwald à Dora, de Bergen-Belsen à Diên Biên Phu, son existence témoigne d’un siècle où la barbarie s’est industrialisée, politisée, et généralisée.
Il aura combattu, parfois aux côtés d’anciens de la Wehrmacht passés à la Légion, les deux grandes idéologies totalitaires de son temps. Son parcours incarne, à lui seul, cette tragédie européenne et coloniale où l’individu se retrouve broyé entre les mâchoires de l’Histoire.
Sources : Bu 7/2-9/9 ; Liste Amicale de Buchenwald ; association buchenwald mitte
Views: 137
Des camps nazis à ceux du Viêt-minh Lire la suite »

Aimé a connu une jeunesse très difficile puisqu’il a été élevé seul par sa mère et qu’il a travaillé très jeune comme garçon de ferme.
Entré très jeune dans la Résistance dans la Sarthe, il participe dans les rangs des FFI à la libération de la région du Mans.
Pour échapper à la misère, il s’engage en 1947 et est affecté au Maroc au sein des tirailleurs marocains.
Volontaire pour combattre en Indochine, à son arrivée il est immédiatement versé au Bataillon de Marche du 8eme Régiment de Tirailleurs Marocains du Commandant Arnault stationné à Cao Bang. Il effectue tout son séjour comme caporal pointeur mortier sur la RC4 déjà surnommée la route de la mort…Il connait son baptême du feu précisément sur la RC4 lors d’une ouverture de route.
En octobre 1950, lors des grands combats de la RC4 où l’Armée française a perdu 5000 hommes en une semaine, il fait partie de la colonne Lepage. Après s’être battu sur les crêtes du Nga N’gaum et du Na Kéo, son bataillon en fin de séjour est totalement anéanti dans les gorges de Coc Xa. Sur les 450 hommes du BM/8emeRTM, il n’y aura que 7 survivants dont Aimé qui, pour échapper aux viets, marchera 3 jours et 3 nuits au milieu des groupes ennemis comme une bête traquée, sans manger et sans boire avant d’être récupéré 20 kilomètres plus au sud, vers That Khé, par une patrouille du 3eme Régiment Etranger d’Infanterie (qui tient tous les postes entre That Khé et Langson).
Son séjour de deux ans n’étant pas terminé, il est affecté dans un poste en Annam où jamais personne ne lui demandera ce qui s’était passé sur la RC4…
A son retour en métropole, il travaille comme tourneur-fraiseur à l’usine mais devant l’hostilité permanente et quotidienne de la CGT et du PCF à l’endroit des combattants d’Indochine, il rengage dans les paras colos.
Breveté au camp de Meucon dans le Morbihan, il est à nouveau volontaire pour servir en Extrême-Orient et est affecté au 8eme Bataillon de Parachutistes de Choc du Commandant Tourret qu’il rejoint à Dien Bien Phu en décembre 1953. Affecté à la compagnie du capitaine Jacky Bailly, il participe à toutes les sorties, reconnaissances offensives autour de la vallée de Dien Bien Phu où les accrochages dans un relief très difficile et recouvert d’une jungle épaisse sont quasi quotidiens.
Après le déclenchement de la bataille, il participe le 28 mars à la destruction des canons de DCA à l’Ouest de la vallée et lors de la bataille des 5 collines, il monte en renfort sur Eliane 2 dès la première nuit de l’offensive (nuit du 31 mars.).
Il est alors marqué par l’intensité extrême des combats sur cette colline et par le fait que pour rejoindre ses emplacements de combat, les gars du « 8 » sont obligés de marcher sur les morts quasiment tous les mètres et même sur les blessés qui agonisent couchés sur les tués et qui ne peuvent être soignés lors d’une offensive de nuit.
Il est de tous les combats jusqu’au 7 mai avant de prendre les pistes de la captivité (53 nuits de marche dont 50 sous la pluie !) qui l’a mené au camp 70.
Fidèle d’entre tous les fidèles, discret, Aimé a été durant près de 40 ans le porte-drapeau officiel et d’un dévouement sans borne au service de l’Association des Anciens Combattants de Dien Bien Phu à la demande des officiers, lui qui n’était qu’un petit caporal-chef.
Views: 53
Aimé TROCME : Un parcours militaire exemplaire Lire la suite »
Mon parcours de prisonnier
du 7 mai 1954 au 31 août 1954
________________________________
La bataille de Dien Bien Phu, moment clé de la guerre d’Indochine, se déroula du 20 novembre 1953 au 7 mai 1954 et opposa, au Tonkin, les forces de l’Union française aux forces du Viet Minh, dans le Nord du Viet Nam actuel. On estime à 2 293 le nombre de soldats français tués lors de cette bataille. Le 7 mai 1954 à 17h30, sans drapeau blanc et en silence, après avoir détruit leurs matériels, les combattants sortent de leurs abris. La garnison française est faite prisonnière par le Viet Minh.
Le décompte des prisonniers des forces de l’Union française, valides ou blessés, capturés à Dien Bien Phu s’élève à 11 721 soldats dont 3 290 seront rendus à la France dans un état sanitaire catastrophique. 8 431 sont morts en captivité. Le destin exact des 3 013 prisonniers d’origine indochinoise reste, quant à lui, toujours inconnu.
Durant leur captivité, les prisonniers ont dû marcher à travers jungles et montagnes sur une distance de 700 km, pour rejoindre les camps, situés aux confins de la frontière chinoise, hors d’atteinte du corps expéditionnaire. C’est cette captivité et ces longues marches que nous racontent notre adhérent, Aimé Trocme, ancien du Be Choc,.ci-après.
17h30 le 7 mai 1954, cela fait une heure que nous avons reçu l’ordre de cesser le feu et de casser nos armes. Un silence terrifiant nous envahi, je suis sur Eliane 10 (point d’appui) avec mon capitaine Gabriel Bailly, voulant retarder d’être prisonnier j’ai franchi le pont (Bailey ?) et rejoint mon emplacement.
Puis des jeunes du Viet Minh viennent avec leurs armes huilées et un chiffon au bout de leurs canons, « Di,di… Maolen… »1. Je passe devant le colonel de Castrie, qui est debout devant son Blockhaus, il est fixe et regarde la direction nord (Torpilleur).
Les soldats du Viet Min nous font de nouveau franchir le pont et puis nous divisent 1 sur 2 en deux colonnes, une se dirigeant à droite d’E/iane 2, et, moi à gauche. De nombreux camarades gisent morts ou blessés.
Stupéfait, je rencontre René Chasseguet, sergent-chef du 4e RTM et que je n’avais jamais revu depuis nos classes à Taza en 1947. « Qu’est ce que tu fous là ? », je lui demande. Il descendait des Elianes.
Je découvre une arme anti-aérienne, qui n’était pas loin de mon emplacement que je n’avais pas vue, et pas loin de là un pauvre gars qui avait le crâne ouvert, il me regarde,

je vois son cerveau bouger ; comme je ne peux rien faire, mon cœur saigne… Je jette unregard circulaire derrière moi, oh surprise, beaucoup d’hommes sortent des trous, là, j’ai pleuré car nous étions peu nombreux à combattre.
Je passe devant Dominique 1 où j’observe en passant qu’elle est creusée comme un tunnel et abrite un canon. Le parachutage en ravitaillement continue, une caisse tombe tout près de nous, vite on prend les cigarettes et la petite bouteille d’alcool, le reste un coup de pied dedans. Si on avait su...
Sitôt rentré en forêt, un immense plaisir me parcourt, j’entends un filet d’eau qui coule de la montagne mais aussi le chant des petits oiseaux. Après environ 15 km, dans une petite clairière sur la droite, en pente, on nous allonge et nous fouille, toutes nos affaires personnelles nous sont retirées : bagues, photo, tout.
Ensuite nous repartons, toujours en longeant le bas de la montagne qui est à droite. Pendant ce temps, nous ne croisons pas beaucoup de monde, sauf une colonne qui vient de la gauche où je vois un homme en combinaison bleu, je demande qui c’est. Un pilote.
Tout à coup, la route devient assez large, et on découvre des rangées de camions molotova et des bidons essence bien camouflés par des bambous.

Une colonne de « nos » Vietnamiens passe à côté de nous, puis nous les doublons à nouveau, la 2e fois, je vois mon tireur F.M., Leeng Sing, de l’autre côté de la route qui me dit : « Chef, maintenant c’est moi Tièt (Mort) ». Je ne les reverrai plus jamais.
Nous sommes très loin de Dien Bien Phu (DBP) et toujours ce silence, je suppose que nous nous dirigeons vers Laï Chau, mais on tourne à droite et crapahute cette haute montagne qui n’en finit pas. Je suis libre de respirer et je reproduis le bruit de l’âne, à plusieurs reprises mais je cesse, car j’ai entendu un Viet Minh, très énervé, manœuvrer la culasse de son arme.
En haut à notre gauche, à 50 mètres , nous voyons à travers les bambous clairsemés des hommes libres, bruyants. J’apprends que c’est un camp de déserteurs.
C’est à partir de cette période qu’ont commencé les grandes douleurs de la captivité. Nous arrivons au col de Co Noï et au col des Méos, qui était tout éboulé, il était très difficile de se croiser avec le défilé de cyclistes avec leurs chargement. Là il y avait du monde, mais peu charitable. Moi je ne me plains pas trop, mais certains civils avec leurs bâtons ont frappé très fort mes camarades en passant, on sentait leur rage.
Plus loin à notre droite, on voit des Vietnamiens enchaînés les uns aux autres et qui encerclent un piton (Mamelon) pour le déminer.
Depuis les montagnes, les sangsues, les tiques, les poux, les puces, les mouches et le béribéri ont fait leur apparition. ils ont été nos fidèles compagnons, nous permettant de passer « d’agréables journées et de bonnes nuits ».
Cela jusqu’au camp et là, vient un complément à notre vie… Les excréments de nos voisins et les nôtres.
Puis brancarder nos copains, souvent ago nisants, avec des moyens de fortune : restant de manches de vestes ou de pantalons enfilés avec deux bambous. Et les laisser là, car nous-mêmes sans force. Quand il y avait une « halte », nous couchions à l’endroit même où nous étions. Bien sûr dénué de tout confort, souvent on restait debout. La pluie continuait de tomber.
Dans la période où nous marchions sur Tuan Giao, les Chinois avec leurs canons étaient à gauche et nous à droite, à Tuan Giao ils ont filé à gauche et nous, nous avons tourné à droite vers Son La.
Puis vint cette longue vallée interminable, on pense que ça ira mieux. On nous donne un buffle à conduire, quelle aubaine ! Nous lui posons nos restants de manches de vestes ou de pantalons remplies de riz, mais avec ses cornes il chasse les mouches et crève les pauvres tissus de nos provisions. Le riz s’étale dans la boue, mais pas de remplacement.
Puis, peu après, on nous dit qu’ils vont tuer le buffle. Nous sommes heureux, on vamanger de la viande. Oui … ils nous ont cuit la peau.

Près de Môc Chau, le 14 juillet dans un petit pré, le Viet Minh a installé une estrade en bambou, et nous a joué au violon et à I’ ac cordéon : « Boire, Manger, et Dormir » et « Princesse Csarda », de très bons musiciens. Puis ils nous ont donné cinq petites sardines sèches, mon petit doigt en faisait deux, la bonté de !’Oncle Ho. Et, surtout, on nous recommande de les économiser car on ne sait pas quand il y en aura d’autres: Sous ma dent, les cinq ont disparu. Mais, comme nous étions déjà en agonie, le moral n’était pas bon. Moi j’ai pleuré pour la deuxième fois.
Nous avons constamment la tristesse de voir l’hécatombe de nos camarades, laissés au bord du chemin, on n’en reverra aucun. Comme à « Souhioute », où il y a un pont maintenant, nous avons enterré après le gué, sur le bord de la route un camarade avec un tas de pierre, il n’y a pas de terre du tout, que des roches.
Nous sommes souvent impuissants pour les secourir, combien nous ont suppliés, nous ont crié leur misère, certains ont appelé leur mère.
Malheureusement nous-mêmes n’avions plus la force de nous traîner ? Malgré toutes ces misères, il fallait continuer à aller chercher le riz souvent à des grandes distances pendant la pause. Nous étions accompagnés de pluie régulièrement, 43 jours de marche dont 37 jours de pluie.
Longtemps j’ai gardé une dizaine de feuilles remplies de noms, donnée à ma libération pour confirmer leurs décès. Mon cœur les a préservés, je les revois sans cesse dans mes pensées.
on n’en reverra aucun.
Un jour nous avons entendu le bruit d’un avion, tout de suite les instructions étaient précises, ne pas bouger sinon… L’avion a parachuté une caisse ou deux, j’ai vu entre les bambous une grande croix rouge, tout de suite certains ont dit qu’ils avaient essayé de prendre la corde pour être hélitreuillé, c’est un mensonge, on n’avait déjà pas assez de force et surtout nous étions bien gardés.
Aux environs de Hoa Binh, mon adjudant de compagnie, Berne, l’adjudant Marius Poirier et moi-même avions décidé de nous évader, Berne connaissant bien les lieux… Nous avions envisagé de faire comme les Viet Minh : couper un bambou, le mettre dans la bouche et passer les lavandières de Hoa Binh, heureusement que nous ne l’avons pas fait, nous avons appris par la suite que les soldats du Viet Minh avaient tendu un filet avec des gamelles.
Mais le plus triste c’est que Berne ne parlait que de ses filles et, quelques jours avant la tentative, il est tombé malade, trois jours plus tard il est décédé.

ll devient impossible maintenant de tenter l’évasion.
Nous passons auprès d’une infirmerie (mouroir). Nous en avons retrouvé l’emplacement en 1992, il y a une dalle à cet endroit, combien sont restés là ?
Nous arrivons au camp 70 où il y a une maison (comme une grange en France), près d’une mare à buffles et canards. Je reste ici une semaine et, comme je ne me conduis pas comme ils le désirent, un gros groupe est trié et conduit au camp 75, un kilomètre plus loin. Là, nous sommes toujours dans un village miséreux, mais où on est quand même à l’abri de la pluie, côte à côte par terre sur des nattes.
Le quotidien malheureusement se résume à des corvées de riz et de bois, si on peut se traîner, autre ment c’est de transporter nos ca marades décédés. Là, les difficul tés deviennent fortes, il était très dur de creuser les emplacements et de trouver une place conve nable. Alors, avec des moyens nuls, nous disposions les corps souvent croisés sur d’autres, re-couverts d’un peu de terre, où les pluies dé couvraient nos amis. La dignité était restée dans notre intérieur.
On mange toujours nos deux rations de riz par jour, une à 10h00 l’autre à 17h00 (une poignée à chaque fois) dans des couverts de choix (des gamelles rouillées).
Nous avons droit à un poulet pour 33 personnes, tant pis si c’est un dé d’os. Il n’y a pas de bagarre, l’agonie est permanente et, pour nous consoler, nous avons la politique de « clémence » tous les matins.
Je n’ai pas vu de faiblesse, de trahison.
Tous ceux que j’ai côtoyés ont été dignes. J’ai compté jusqu’à 13 décès par jour dans ce camp 75, où nous étions trois groupes de 10, reconstitués automatiquement. Et je ne connais aucun autre chiffre de perte en mémoire.
Un jour, épuisé, le visage au ras du sol, je suis émerveillé par une minuscule fleur qui se fraye un passage dans les cailloux, cette révélation me réconcilie avec la religion, car elle et la société n’avaient plus de valeur (il y a un « Créateur » : quand un camion de planches se renverse contre un mur, il n’en sort pas une maison).
Aux alentours du 15 août, on a annoncé notre proche libération. Quel remue-ménage dans notre tête ! Puis nous voyons passer devant nous d’autres soldats, nous on enrage…
Le temps est long à venir, et enfin on nous distribue des vêtements verts, des sandales, un chapeau.
Dans quelques jours, nous partirons vers la rivière proche et monterons sur des petites barques pendant plusieurs kilomètres, puis nous marcherons encore un certain temps, et arriverons à Sam Son. Là, un rideau de bambous tressés est planté, derrière on voit la mer, mais surtout il y a des tables en bambou où des médecins examinent les arrivants.

C’est long d’attendre ! Les soldats du Viet Minh nous disent la mauvaise volonté des Français pour nous recevoir… cela n’empêche pas nos camarades de mourir.
Pour aggraver la situation, le Viet Minh nous donne des cuvettes de pâtes de riz à manger. (À leur retour d’Allemagne, beaucoup de prisonniers sont morts pour av9ir trop mangé). Je suis fier dans mon intérieur d’avoir peut-être sauvé quelques camarades.
Enfin mon tour arrive ! Le 31 août 1954, le LCT (Landing Craft Tank), le bateau au large, direction Haiphong. Hôpital, B 12…
Puis le centre de repos de Dalat Haut (un mois) puis diriger vers la BMS (Base Militaire de Saïgon) (8 jours) pour mon rapatriement.
Deux choses se sont produites à mon insu : La première lors d’une pause avant l’arrivée au camp, j’avais besoin d’aller aux toilettes, j’ai dû aller au bosquet plus loin. Ouand je me suis relevé, j’ai pensé mourir, un habitant d’une maison proche venait à ma rencontre et je savais qu’il pouvait obtenir une prime de scalp. Il s’approche et me parle en bon français, me disant qu’il était autrefois dans l’armée française, et qu’il avait été blessé par des mortiers Viet Minh. Maintenant il est heureux, il a sa femme, son buffle, sa basse cour, son lopin de terre. Ça lui suffit.
La 2e, plus glorieuse, vient d’un vrai copain, j’ai appris par la suite qu’il s’appelait « La Cerise ». Ce jour-là, étant très mal en point, je suis resté au camp, marchant avec deux bâtons, il arrive de corvée, me voyant, surpris, il me dit : Toi mémé… ce n’est pas possible !
Cela m’a sûrement donné du tonus puisque je suis là aujourd’hui,1 les remerciements ne suffisent pas.
Aimé Trocme
8e Choc – Capitaine Pierre Tourret
3e Cie – Capitaine Gabriel Bailly (S.A.S.)
3e Section 3e Groupe – Sergent René

NDLR : À la fin de l’année 1953, commandé par le capitaine Pierre Tourret, le 8e Bataillon de Parachutistes Coloniaux, rebaptisé 8e Bataillon Parachutiste de Choc depuis le 1er août, saute à Dien Bien Phu. Il sera l’un des deux bataillons à vivre toute la bataille, de novembre 1953 à mai 1954.
Le 8e BPC (Bataillon de Parachutistes Coloniaux – 8e Choc) aura gagné quatre citations à l’ordre de l’Armée en Indochine.
_________________________________
Site internet de l’Association Nationale des Anciens Prisonniers Internés et Déportés d’Indochine (ANAPI) : http://www.anapi.fr/
Site internet de l’Amicale des anciens du 8e RPIMA :
Ouvrages dans le même style :
Armé pour la vie d’André Boissinot, lndo éditions.
Camp 113 de Wladyslaw Sobanski, éditions Almathé.
Views: 26
Le parcours de prisonnier de AIME TROCME Lire la suite »
