“Un enfant en Indochine Française – Mai 1939-Août 1945”
UN ENFANT EN
INDOCHINE FRANCAISE
Mai 1939-Août 1945
par le Général Michel PRUGNAT
Témoignages auprès de la Commission d’histoire de la guerre
de l’ Université de LYON III
les 17 mars et 21 avril 1998.
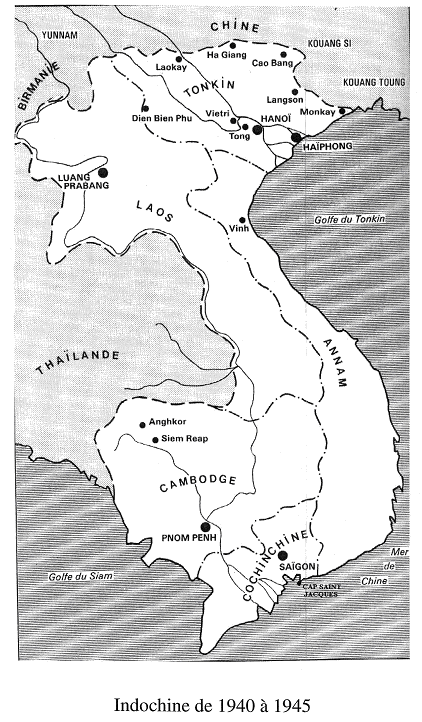
Mai 1939
Nous sommes sur le quai de la gare de Libourne, une ville de garnison du département de la Gironde, où mon père a été affecté deux ans plus tôt comme commandant de batterie au 1er Régiment d’artillerie coloniale, au retour d’un séjour de quatre années en Chine. Un canonnier sénégalais tient dans ses bras un petit garçon de quatre ans qu’il ne veut plus lâcher. C’est TINI KOURA, l’ordonnance de mon père.
Et moi, j’ai l’habitude d’être porté par ce grand et solide gaillard. Nous sommes, mes parents, mon frère aîné âgé de six ans et demi et moi-même, sa famille d’adoption ; il est bouleversé de nous voir partir pour l’Indochine où mon père vient d’être affecté pour deux ans. Non content de nous avoir prodigué son dévouement et son affection, TINI KOURA donnera quelques mois plus tard, sa vie pour la France.
Quelques heures après, nous arrivons à Marseille où nous retrouvons nos grands-parents venus de Paris dire au revoir à leurs enfants et petits-enfants qui « partent pour la colonie ». Lorsque, deux jours après, le bateau s’éloigne du quai et que conformément à la tradition, ils agitent leurs mouchoirs en guise d’adieu, ils ne se doutent pas qu’ils ne nous reverront que sept ans plus tard.
Nous aurons, les uns en France, les autres en Indochine, vécu des événements exceptionnels. Mais si les premiers sont dans l’ensemble bien connus, en particulier grâce aux émouvants témoignages recueillis par notre commission, il semblerait que ceux qui se sont déroulés à la même époque dans notre lointaine colonie le soient bien moins.
J’ai donc cédé à l’amicale pression de notre président pour vous livrer un témoignage sur la vie en Indochine française, entre juin 1939 et août 1945, telle qu’a pu la percevoir et en garder le souvenir un enfant, entre l’âge de quatre ans et l’âge de dix ans
C’est avec une grande émotion, vous vous en doutez, que j’ai revécu en pensée ces moments là et je dédie affectueusement ce récit à mes parents qui, dans ces circonstances parfois dramatiques, ont su, chacun dans leur domaine, faire preuve d’un sang froid et d’un courage exemplaires.
Nous voici donc, après une traversée maritime de trente jours, parvenus à notre destination indochinoise, le CAP SAINT-JACQUES. C’est une station balnéaire située à environ 120 Km de SAIGON, à l’embouchure de la rivière qu’empruntent les bateaux pour remonter jusqu’à cette grande ville cochinchinoise. Il y règne un climat chaud et humide, analogue à celui des Antilles françaises, qui permet de se baigner toute l’année.
Mon père est affecté successivement au 4ème Régiment d’artillerie coloniale et à l’Etat major, comme chef du deuxième bureau, sous les ordres du Général GOUACHON qui était son chef de corps à Libourne et qui, l’ayant apprécié, a demandé qu’il vienne le rejoindre en Indochine.
Deux années s’écoulent, deux années de rêve pour un jeune garçon qui passe un tiers de sa vie à jouer, le deuxième dans l’eau et le troisième à dormir. Il n’y a rien de particulier à signaler sur cette période, si ce n’est l’absence de certains pères qui sont partis pour le Cambodge, en raison du conflit qui oppose la France au Siam ; ils reviendront quelques semaines plus tard.
Il convient cependant de relater un événement assez particulier qui a perturbé la vie de la garnison pendant quelques jours à cette époque là.

Un matin, mon père reçoit, à l’Etat major, la visite d’un sous-officier, qui a insisté pour le voir car il a une information très importante à lui communiquer.
Son épouse, qui est Indochinoise, vient d’apprendre, de source sûre, que des révolutionnaires se réunissent régulièrement de nuit dans le grand massif, une des collines qui domine le CAP SAINT-JACQUES.
Ils doivent, à une date que j’ai oubliée, attaquer la ville et massacrer tous les Français qui s’y trouvent. Au préalable, les cuisiniers devront avoir versé du poison dans la soupe.
Bien que cette information lui paraisse peu fondée, mon père, par acquit de conscience, en rend compte au Général. Celui-ci, sans hésiter, prend immédiatement les mesures de sécurité qui s’imposent.
Les sentinelles sont doublées, les patrouilles multipliées et les familles doivent se regrouper à quatre ou cinq par maison pour passer la nuit. Pour ce qui nous concerne, nous allons coucher à la résidence du général, comme quelques autres familles d’officiers affectés à l’Etat major. Rien ne se passe et ces dispositions sont levées au bout de quatre jours.
Presque deux ans plus tard, mon père devenu chef du deuxième bureau à l’Etat major de HANOI, verra passer une note faisant état de l’arrestation en Cochinchine d’un groupe de dissidents. Ils détenaient des archives indiquant qu’une attaque de la garnison du Cap Saint Jacques avait été envisagée deux ans auparavant, mais que, en raison de l’importance des mesures de sécurité prises, ils avaient dû y renoncer.
Malgré quelques péripéties, la vie que l’on mène dans cette garnison est proche de celle du temps de paix, jusqu’à ce jour de l’été 1941 où débarquent de curieux soldats portant un uniforme jaunâtre et une casquette de toile. Ils parlent une langue que je ne comprends pas et ont un comportement bizarre parfois. Un matin, une compagnie arrive sur la plage que nous fréquentons habituellement. Sur ordre de leur chef, ils se dévêtent totalement et, un savon à la main, entrent dans l’eau et se lavent ; en quelques secondes, la plage s’est vidée de tous ses occupants. C’est notre premier contact avec l’armée nipponne.
Ils prennent leurs quartiers en ville et se répandent un peu partout. Il va désormais falloir vivre avec ces gens là. D’instinct, je ne les aime pas trop et, ayant remarqué qu’une escouade passait régulièrement devant notre portail, je m’installe en embuscade avec ma mitrailleuse rouge, made in Japan, qui crache le feu grâce à une pierre à briquet intégrée.
Au moment où ils sont à proximité, je leur lâche une longue rafale, ce qui déclenche chez eux une grande hilarité. Je renouvellerai quelques autres fois l’expérience, mais, obtenant toujours le même résultat, je me rallierai à la coexistence pacifique qui est devenue la règle en Indochine.
Quelques semaines après, j’effectue ma rentrée scolaire. Ma première institutrice est une Indochinoise, vêtue des habits traditionnels de son pays. Cela ne me surprend pas. Voilà deux ans que je vis au contact des Indochinois et je commence à connaître quelques rudiments de leur langue.
Nous sommes maintenant habitués aux Japonais ; on a réussi, même à la plage, à trouver un modus vivendi acceptable.
De temps en temps, je pousse une reconnaissance à bicyclette vers le stade où ils s’entraînent à l’escrime à la baïonnette avec des fusils en bois. Ils le font en poussant des cris impressionnants, comme ceux que j’aurai l’occasion d’entendre plus tard, en d’autres circonstances.
Mon père est promu au grade de chef d’escadron en 1942 et, en août, nous quittons le CAP SAINT-JACQUES pour HANOI où il a été muté.
Nous prenons le train à SAIGON, pour un trajet d’environ 2 000 Km effectué en grande partie de nuit, à cause des risques de bombardement.
Nous avons l’opportunité de nous arrêter à HUE
pendant trois jours et, malgré mes sept ans, je suis émerveillé par cette ville et par la visite des tombeaux des empereurs d’Annam.

Après une longue nuit et une demi-journée en train, nous franchissons le FLEUVE ROUGE sur le PONT DOUMER et débarquons à la gare de HANOI.
La capitale de l’Indochine est une ville de province française, avec sa grande artère commerçante, la rue Paul Bert, avec des grands magasins, des boutiques de luxe, des officines ou des agences commerciales qui portent des noms bien français, comme les Grands magasins réunis, Coryse Salomé ou Descours et Cabaud, bien connu des Lyonnais.
Les Japonais y sont présents, bien sûr, mais, comme nous sommes en ville, ils paraissent plus dilués. Il y a aussi le théâtre dont l’architecture est inspirée de celle de l’opéra Garnier à Paris, la cathédrale, le stade municipal, l’université et le Lycée Albert Sarraut dont nous devenons mon frère et moi les élèves, respectivement au Grand lycée et au Petit lycée.
Mon frère entre en 6ème ; avec mes sept ans, j’entre plus modestement en 9ème, mais, malgré mon jeune âge, je suis soumis, comme tous, au règlement sévère de l’établissement.
Les classes commencent à 7 heures le matin et, comme nous habitons à l’autre extrémité de la ville, cela nous oblige à quitter la maison en pousse-pousse, une demi-heure plus tôt ; nous sommes demi- pensionnaires et, tributaire de mon frère, je quitte le lycée après l’étude du soir, à 20 heures.
Le port du casque colonial et la sieste après le déjeuner sont obligatoires ; de sévères punitions auront vite fait de me le rappeler. Les débuts et fins de classe sont marqués par un roulement de tam tam.
A l’heure de la récréation, nous sommes rassemblés au pied du mât de pavillon ; tandis que les couleurs montent, nous effectuons le salut olympique, le bras levé, après que la main ait frappé la poitrine, puis nous chantons un couplet de la Marseillaise (nous entrerons dans la carrière…) et le célèbre « Maréchal, nous voilà ».
Lorsque nous nous rendons au stade, nous le faisons au pas cadencé, en chantant. Les chants de marche nous sont enseignés par notre professeur de musique, une vieille femme (au moins 50 ans !) qui va même jusqu’à en composer.
J’ai encore en tête le final de l’un d’eux :
Aujourd’hui dans la peine,
La gloire pour demain,
La France souveraine,
Surgira par Pétain.
Les journées me semblent une éternité puisque je suis astreint, en plus des heures de classe, à quatre heures d’étude quotidienne, avec interdiction de lire autre chose que des ouvrages scolaires.
Je finis par connaître par coeur mes livres de lecture, d’histoire et de géographie ou les quelques vieux bouquins qui traînent dans les casiers.
Il y a dans ma classe des élèves indochinois qui travaillent très bien, mais ont en moyenne cinq ans de plus que nous. Si j’admets qu’ils soient plus forts en calcul, je refuse de m’en laisser conter en Français ou en Histoire.
Je me sens très Français, contemplant avec nostalgie la couverture de mon livre de géographie, qui représente une maison alsacienne dans la neige et, très solidaire des petits Alsaciens-Lorrains éloignés comme moi de la Mère Patrie.
Ce n’est que longtemps plus tard que je réaliserai que certains vieux ouvrages du lycée étaient encore imprégnés de l’esprit de la Grande revanche.
Les classes sont de temps en temps interrompues par des alertes aériennes et nous nous rendons dans les tranchées creusées le long du stade.
Une de ces alertes viendra d’ailleurs opportunément mettre un terme rapide au fastidieux et long discours de la cérémonie de distribution des prix.

Les bombardiers américains venant de Chine s’en prennent en général aux installations japonaises, en particulier à l’aérodrome de GIA LAM, situé de l’autre côté du FLEUVE ROUGE.
Ils sont escortés par des chasseurs et pris à partie par la chasse et la D.C.A japonaises.
Le pont DOUMER, qui traverse le fleuve, est souvent attaqué par les Américains qui ne parviendront jamais à le détruire. Il faut dire qu’il est âprement défendu car d’un intérêt vital.
Notre vie quotidienne doit prendre en compte la spécificité liée au pays et à l’état de guerre.
Il n’y a plus de liaisons avec la métropole et cela pose des problèmes d’ordre affectif, matériel ou sanitaire.
– D’ordre affectif, car on ne peut communiquer avec sa famille proche en métropole que par message radio codé ne mentionnant que des événements familiaux (naissance, mariage, décès) à l’exclusion de toute autre information. Nombreux sont chez les militaires ceux qui ont laissé en France une épouse ou une fiancée.
– D’ordre matériel, puisque certaines denrées manquent cruellement.
Le lait est réservé aux nourrissons, les enfants sont sevrés au bout de quelques mois et il n’y ni blé ni chocolat. En guise de petit déjeuner, nous prenons du thé et une tranche de boule de riz compressé avec de la confiture de fruits locaux.
D’une façon générale, nous souffrons du climat chaud et humide et avons peu d’appétit. Les objets « made in France » se font de plus en plus rares et sont, quand cela est possible, remplacés par des produits de fabrication locale ou des articles japonais, presque tous de mauvaise qualité. On ne trouve par exemple plus de crayons de couleurs, à l’exception des crayons bleu ou rouge.
– D’ordre sanitaire, en raison des maladies coloniales, dysenterie, parasites, paludisme etc. qui viennent s’ajouter aux maladies habituelles.
Les soins médicaux aux familles sont assurés par les médecins militaires et l’hôpital militaire de LANESSAN. Une sorte de choléra infantile frappe les tout jeunes enfants et les emporte en quelques heures.
Les médecins sont impuissants devant cette maladie dont ils ignorent la cause et qu’ils n’ont pas les moyens de soigner. Rares sont les familles qui n’ont pas été confrontées à ce drame.
Nous habitons un pavillon avec un grand jardin dans la cité des cadres militaires. Nous disposons de personnel de maison.
Le boy est chargé du ménage et du service à table, le bep de la cuisine et du repassage. Il y a souvent en plus une Thi-aï pour s’occuper des jeunes enfants, ce qui sera notre cas quelques mois après notre arrivée à HANOI, avec la naissance de notre petite soeur, en février 1943.
On peut également avoir un coolie-pousse si l’on possède un pousse-pousse particulier. Les gens se reçoivent beaucoup et jouent au bridge chez eux ou au cercle des officiers qui, outre les salons et salles à manger, dispose d’une grande piscine et d’une importante bibliothèque, avec une section pour les jeunes, que nous fréquentons assidûment.
Nous n’avons pas de radio mais allons assez souvent au cinéma et voyons les actualités auxquelles je ne comprends pas grand chose. A la fin de chaque séance, toute la salle se lève, tandis que l’on projette un portrait du Maréchal Pétain et que retentit la Marseillaise, suivie de l’hymne de l’Empereur d’Annam.
Nos parents lisent le journal local, l’Opinion. L’Imprimerie d’extrême orient édite sur un papier de couleur beige et de mauvaise qualité les oeuvres des écrivains locaux ou réédite des oeuvres françaises.
C’est ainsi que nous pourrons découvrir et apprendre avec notre mère les chansons du folklore français.
Elle imprime également des timbres-poste à travers lesquels nous apprenons les noms des grands hommes qui ont fait l’Indochine française.
Presque personne n’a de gramophone, les disques sont rares et on ne trouve pas d’aiguille pour les passer. Outre la cathédrale, chaque quartier a sa paroisse avec des offices réservés aux Indochinois qui peuvent y entendre prêcher dans leur langue.
Il n’y a pratiquement plus d’essence et les véhicules à moteur ont été transformés pour fonctionner à l’alcool ou au gazogène. Le moyen de transport le plus utilisé est la bicyclette, mais on circule aussi beaucoup en pousse-pousse ou en cyclo-pousse. Un tramway relie le pittoresque quartier indochinois à la partie française, mais nous ne l’empruntons jamais car il est toujours bondé et pratiquement inaccessible, en raison des voyageurs agglutinés en grappe sur les marchepieds.
A notre arrivée à HANOI, notre père a été affecté au 2ème bureau de l’état-major et de ce fait, est amené à rencontrer des officiers ou des responsables japonais. Il est parfois confronté à de situations délicates.
Les Japonais par exemple ne comprennent pas pourquoi on ne retrouve que très rarement à bord des avions alliés abattus les documents de bord, les cartes, l’armement ou les munitions. Tous ces objets sont en fait recueillis par des équipes de recherche françaises et, de temps en temps, sur notre demande, il nous en montre quelques uns. C’est ainsi que nous pouvons un jour examiner une trousse de secours pharmaceutique, en parfait état, qu’il remettra quelques jours plus tard à un de ses camarades, médecin militaire.
Nous menons une vie à peu près normale ; nous ne sommes pas vraiment concernés par les alertes aériennes et, dans la matinée du vendredi 10 décembre 1943, la totalité du lycée, comme c’est la règle, rejoint les tranchées au moment où retentissent les sirènes.
La ville, pour la première fois, est soumise à un violent bombardement aérien qui provoque des dégâts considérables et de nombreuses victimes, malheureusement pas aux endroits prévus. Les installations militaires françaises sont fortement endommagées ; des bombes incendiaires sont tombées sur le stade et à proximité du lycée et de puissantes bombes l’ont manqué de peu. Les familles affolées se précipitent au lycée à la fin de l’alerte pour prendre des nouvelles de leurs enfants. Il n’y a heureusement aucune victime.
Les classes reprennent normalement le lendemain, mais un bombardement plus violent encore, le dimanche 12 décembre, secoue la ville ; de nombreuses bombes tombent à nouveau à proximité du lycée.
Les autorités locales décident alors de fermer l’établissement et de le transférer au TAM DAO, une station climatique située à 1200 mètres d’altitude, sur une montagne qui domine HANOI. Il est en outre fortement recommandé aux femmes et aux enfants, dont la présence n’est pas indispensable, de quitter la ville.
Un grand nombre de familles va donc s’installer là-bas. Notre mère pour sa part décide que nous resterons tous à HANOI avec notre père et, se substituant aux professeurs, nous fait la classe à la maison ; la grande affection que je lui porte est quelque peu troublée lorsque je la vois se transformer en une institutrice sévère et exigeante.
Je tiens ici à lui rendre hommage et à souligner avec quel courage, quelle énergie, elle s’est attachée à ce que les circonstances que nous vivions ne perturbent pas nos études. Je tiens modestement à dire que, de notre côté, nous ne l’avons pas déçue mon frère et moi. La vie est transformée à HANOI et le fait de ne plus retrouver mes camarades en classe me manque. Seul subsiste le cours de catéchisme à la paroisse Saint Antoine, mais j’en suis l’unique élève.
Quatre événements, très importants pour moi, marquent cette période :
En premier lieu un nouveau bombardement, en mars 1944, vient éprouver la ville ; nous sommes chez nous et n’avons pas le temps de rejoindre l’abri de l’état-major. Il y a heureusement une tranchée dans notre jardin, que je connais bien car j’y passe de longues heures à jouer à la guerre.
Nous nous y précipitons en toute hâte et y retrouvons le personnel de maison. C’est la fin de l’hiver et la tranchée s’est remplie d’eau ; j’en ai jusqu’à la ceinture.
Notre brave coolie-pousse, à côté de moi, est terrorisé. Il pleure toutes les larmes de son corps et fait un signe de croix à chaque explosion.
Lorsque les avions sont à notre verticale, je lui explique que nous ne risquons plus rien, compte tenu de la trajectoire des bombes, mais le pauvre n’est pas en état de comprendre mes théories. A l’issue du bombardement, notre mère, qui a suivi un stage de secouriste, passe son brassard à croix rouge et rejoint l’hôpital à bicyclette pour aider à soigner les blessés.
Une autre fois, nous sommes réveillés mon frère et moi en pleine nuit ; le salon est allumé et nous entendons parler nos parents.
Nous nous levons pour voir ce qu’il se passe. Notre mère, bouleversée, tient dans ses bras notre petite sœur de quinze mois qui présente tous les symptômes de ce fameux choléra infantile. Notre père s’est habillé à la hâte et, sous une pluie torrentielle, part à bicyclette chercher un médecin capitaine, qui est également un ami.
Il arrive rapidement et, examinant notre petite sœur tout en questionnant nos parents, ne peut que leur faire part de son impuissance. Il a lui même perdu une petite fille du même âge et dans les mêmes circonstances.
Mais, se ravisant tout à coup, il ouvre sa sacoche et en extrait la trousse de secours américaine que notre père lui a remise quelque temps plus tôt. Il en sort un tube de comprimés blancs et, après en avoir, aidé de notre père, traduit la notice d’emploi, il administre, en désespoir de cause, ce médicament au bébé ; en quelques heures notre petite sœur renaît à la vie. Nous venons de découvrir l’effet miraculeux des sulfamides.
Lorsque je repense à cet épisode, je me dis que le sacrifice de cet équipage de bombardier américain tombé un jour sur le sol tonkinois n’a pas été vain, puisqu’il a au moins permis de sauver la vie d’une petite Française.
Le moment de ma première communion approche et je suis toujours seul à assister au cours de catéchisme, dispensé par une vieille dame un peu folle qui m’explique ce qu’est le diable en me parlant de Hitler qui en est la réincarnation, car il adore le feu. Finalement le curé réussit à recruter et à former en accéléré trois garçons et trois filles qui, le 7 mai 1944, partageront avec moi ce grand événement.
Ce même jour, en fin d’après midi, nous empruntons pour nous rendre aux vêpres, sous une pluie diluvienne, deux pousse-pousse. Je suis avec mon père dans le premier, ma mère et mon frère nous suivent à quelques mètres derrière. Une violente bourrasque déracine un très gros arbre qui vient s’abattre sur la chaussée, entre les deux véhicules.
Un mois plus tard, notre père bénéficie de quelques jours de repos que nous devons passer à CHAPA, une station climatique très connue des Français du Tonkin. Nous nous y rendons par le train, de nuit, à cause des bombardements.
A VIETRI, nous empruntons un bac pour traverser la rivière puis, après une journée d’attente dans un centre de repos de la Légion étrangère, nous reprenons le soir le train à destination de LAOKAY, une bourgade située à la frontière de Chine.
Nous ne nous doutons pas que tous ces sites seront, quelques mois plus tard, le théâtre de violents combats contre les Japonais auxquels participera notre père. Le pont qui enjambe le FLEUVE ROUGE et sépare LAOKAY de la Chine a été démoli par les Américains. Je contemple avec fierté et émotion le pays où je suis né neuf ans plus tôt.
CHAPA est une station de montagne située à 1500 mètres d’altitude, dont le climat rappelle celui de la France. Nous prenons pension à la Villa Pennequin, un hôtel de vacances géré par l’Armée. Le site est splendide et il n’y a pas de Japonais donc pas de risque de bombardement ; de la terrasse de l’hôtel on peut admirer le FAN SI PAN, point culminant de l’Indochine et, dans le lointain, les montagnes de Chine.
Nous mangeons comme des ogres, nous promenons en montagne en famille et notre père ne peut s’empêcher de nous parler des Alpes, où il allait en vacances avec ses parents. Les estivants parlent tous de la France et cela me donne très envie d’y retourner. Voilà cinq ans déjà que nous avons quitté la Mère Patrie et cela représente plus de la moitié de ma vie. Mais ce bonheur, ce calme et cette sérénité ne seront que de courte durée.
Quelque temps après ces vacances, nous apprenons que notre père doit quitter ses fonctions à l’état-major pour prendre le commandement d’un groupe d’artillerie.
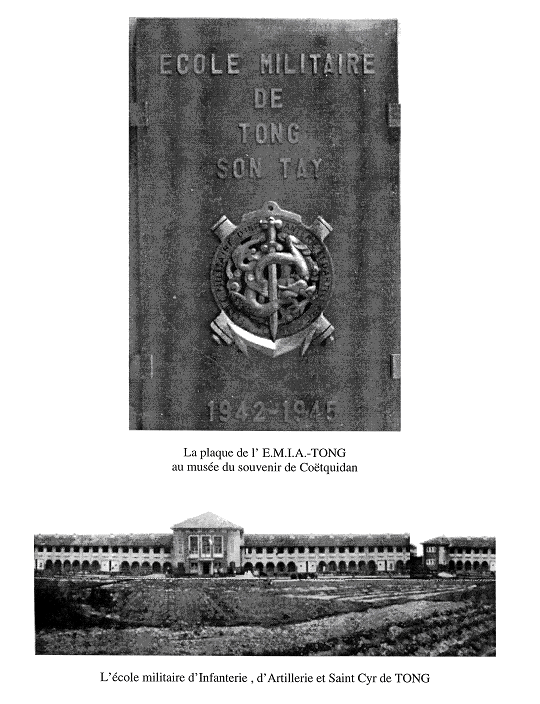
Deux propositions lui sont faites, se situant à LANG SON ou à TONG. Il est très attiré par LANG SON où il souhaite servir depuis de longues années, mais le Camp militaire de TONG se trouve à trois kilomètres de la ville de SONTAY où fonctionne un lycée ; il opte donc pour cette affectation.
Son destin se joue ce jour là, car, quelques mois plus tard, le commandant du groupe d’artillerie de LANG SON sera, comme la quasi totalité des officiers de cette garnison, tué au cours des combats du 9 mars 1945 contre les japonais. Nous sommes à la fin du mois d’août ; je m’en souviens car j’entends un jour mon père rentrant déjeuner dire à ma mère : « Paris a été libéré ».
La rentrée scolaire a lieu le 15 septembre, mais, mon père ne devant rejoindre son affectation que début octobre, mon frère qui entre en quatrième au lycée de SON TAY, est accueilli, en attendant notre arrivée, par le Capitaine VAN VEYENBERG et son épouse. Ce capitaine, d’origine hollandaise, est un polytechnicien qui appartient à la Légion étrangère. Il est professeur de mathématiques à l’Ecole militaire de TONG.
TONG est une garnison importante d’environ 6000 hommes, 1200 européens (dont 700 légionnaires) et 4800 Indochinois. Cela correspond à une brigade pour l’Armée de terre et à une base aérienne pour l’Aviation militaire. Nous nous y installons début octobre. Mon père prend le commandement du 3ème groupe du 4ème Régiment d’artillerie coloniale.
Cette garnison est aussi très connue à l’époque, en Indochine, pour son école de formation d’officiers, l’Ecole de TONG. Le 5 mai 1979, une plaque commémorative a été apposée à l’Ecole de Saint-Cyr COETQUIDAN pour en perpétuer le souvenir.
Voici un extrait de ce qu’écrivait à ce sujet Pierre Darcourt dans un article du Figaro paru ce jour là :
« Créée au Tonkin à l’automne de 1942, alors que l’Indochine était totalement coupée de la France, l’Ecole d’infanterie et d’artillerie de TONG avait pour but de former sur place des cadres d’un niveau correspondant aux écoles de métropole, constituée pour assurer non seulement l’encadrement des officiers d’active, mais aussi pour ne pas priver les jeunes gens, militaires ou civils, de faire une carrière dans l’armée.
L’installation de cette école au camp militaire de TONG (à 40 Kilomètres de HANOI), où étaient déjà cantonnées des troupes de toutes armes, terre et air, offrait, en outre l’avantage de terrains de manœuvre pratiquement illimités.
Cinq promotions sont sorties de l’E.M.I.A. de TONG, totalisant cent neuf officiers.
Tous furent nommés sous-lieutenant et répartis dans les unités combattantes au moment du coup de force japonais du 9 mars 1945.
Sur ces cent neuf officiers, vingt-cinq furent tués au combat. Ces jeunes cadres ont combattu avec courage, mais sans espoir, car ils ont su très tôt que personne ne viendrait les aider dans une lutte inégale, menée uniquement pour l’honneur de nos armes ».
J’ajouterai, tout comme l’auteur, que ces jeunes officiers ont participé « à des faits d’armes dignes des plus grands moments de notre histoire ».
Pour ma part, j’entre avec quelques jours de retard en 7ème (CM2) à l’école primaire. Je suis heureux d’être à nouveau scolarisé.
Nous menons à ce moment là, à TONG, une vie de garnison proche de celle du temps de paix. Il n’y a pas de Japonais, donc ni alerte ni bombardement. Le camp est installé au pied du MONT BAVI qui culmine à 1200 mètres.
Dans la montagne, une ferme laiterie, où nous avons un jour l’occasion de nous rendre, est tenue par un couple de Français. Je suis émerveillé car je n’ai jusqu’à présent vu de ferme que dans mes livres d’images. Mais le point fort de cette visite est pour moi la dégustation d’un petit suisse. Cela fait quatre ans que je n’ai pas consommé de laitage et j’en ai oublié le goût.
Nous logeons dans un agréable pavillon, à proximité du mess des officiers. Comme il est d’usage outre-mer, les officiers se reçoivent souvent les uns les autres et, comme la France est maintenant libérée, les consignes relatives à l’interdiction des manifestations dansantes sont assez souvent transgressées. Une petite formation musicale de la Légion étrangère anime des soirées privées et le Commandant d’armes et son épouse s’éclipsent discrètement lorsque les invités commencent à danser.
Au début du mois de décembre, nous sommes invités à la fête de l’école militaire de TONG et j’assiste, pour la première fois, à la reconstitution de la bataille d’Austerlitz. Je rêve d’imiter, quand j’aurai leur âge, ces jeunes et brillants aspirants ; je reconnais parmi eux l’aspirant CLEMENT qui était surveillant de dortoir au lycée d’HANOI, à qui j’étais redevable de quelques heures de colle et qui tombera vaillamment quelques mois plus tard sous les balles japonaises. Pour ma part, je réaliserai mon rêve quelques années après à Saint-Cyr où je servirai, le 2 décembre, sous les ordres de Koutousof en première année et dans la Garde impériale en seconde année.
La vie se déroule agréablement à TONG ; nous fêtons Noël en famille et, le 31 décembre, nos parents se rendent à une soirée costumée chez la fille aînée du commandant d’armes, épouse d’un lieutenant de la Légion étrangère. Presque tous les officiers de la garnison et leurs femmes sont là, l’ambiance est joyeuse et les invités, comme mes parents, rentrent chez eux fort tard. Quelques heures après, la fanfare du 3ème Groupe d’artillerie vient chez nous souhaiter une bonne année à son chef ; de même la musique du 1er Bataillon de Légion vient donner l’aubade au sien, le Capitaine GAUCHER, notre voisin, qui sera tué quelques années plus tard à DIEN BIEN PHU et donnera son nom à une promotion de Saint-Cyr.
Nous sommes, en ce début d’année 1945, à l’aube de mes dix ans, que je fêterai joyeusement le 11février, entouré de nombreux amis.
Vers la fin de ce mois, des événements curieux se produisent. Des convois militaires japonais traversent le camp militaire de TONG à plusieurs reprises et s’arrêtent assez longtemps, en plein centre, toujours devant une caserne ou un quartier militaire. J’ai remarqué ce manège lors de reconnaissances à bicyclette et j’en parle à mon père, qui a découvert leur stratagème immuable :
le véhicule de tête tombe en panne ; le conducteur descend, soulève le capot du moteur et tente, sans succès, de le remettre en route. Au bout d’un certain temps, l’officier chef de convoi, nanti de son sabre et bardé de sacoches, impatient et furieux, descend de son véhicule pour s’enquérir de la situation et, ce faisant, perd une minuscule pièce de son harnachement. Aussitôt, des soldats sautent des camions et, à quatre pattes par terre, tentent de la retrouver. Pendant ce temps, dans les cabines des camions arrêtés, les officiers de renseignement observent et prennent des notes, voire des photographies.
Bizarre ! D’habitude, on ne voit jamais de Japonais à TONG.
Dans la nuit du 8 au 9 mars 1945, les troupes en manœuvres ont quitté la garnison et nous ne sommes pas surpris, car cela fait partie de la vie courante. Nous allons en classe normalement et nous retrouvons notre père pour le déjeuner. Les troupes ont en effet regagné la garnison à la hâte, en raison de mouvements et de manoeuvres inhabituelles des troupes japonaises.
L’après-midi, à l’école, les commentaires sur les Japonais vont bon train. Rentré à la maison, comme d’habitude, je fais mes devoirs, j’apprends mes leçons, puis je vais rejoindre les enfants du quartier qui se sont regroupés autour du portique à balançoires situé devant notre portail. A quelques mètres de là, au cercle des officiers, le Général ALESSANDRI, Commandant la brigade à laquelle appartiennent les éléments de TONG, a rassemblé un certain nombre d’officiers et leurs épouses autour d’un apéritif, pour leur donner ses instructions en cas d’attaque de la garnison par les forces japonaises.
Nos parents sont de retour vers 19 heures et nous dînons rapidement, car notre père doit retourner au quartier, les troupes étant consignées. Il nous explique avant de repartir que TONG est déclarée « Ville ouverte », ce qui signifie qu’en cas d’attaque japonaise, les militaires quitteront la garnison, à l’exception du Lieutenant-colonel MARCELLIN, le Commandant d’armes et de quelques autres militaires, officiers et sous-officiers, dont la mission sera de remettre les installations militaires aux Japonais. Il nous promet qu’il ne quittera pas la garnison sans venir nous dire au revoir et part rejoindre son quartier.
Nous nous couchons mon frère et moi sans grande conviction, tandis que notre mère prépare deux petites valises, dans lesquelles elle dispose les quelques objets indispensables dont toute maman connaît d’instinct l’inventaire.
Elle les a choisies petites, de façon que mon frère ou moi puissions les porter sans difficulté, ou qu’elle-même puisse en porter une, avec notre petite soeur sur l’autre bras.
Vers 21H 30, nous entendons un bruit de moteur, celui d’une voiture qui se rapproche de la maison puis des bruits de pas sur les graviers du jardin. C’est papa ! Nous nous précipitons dans la chambre des parents où nous retrouvons notre père qui a monté l’escalier à grande vitesse. Il nous dit : «Les Japonais sont à trois kilomètres d’ici et commencent à encercler la garnison ; HANOI a été attaquée et le téléphone a été coupé.
Partez immédiatement vous réfugier à l’infirmerie. » Il sort son portefeuille, remet à notre mère, en complément de ce qu’elle a déjà, la quasi totalité de son contenu, puis il nous serre rapidement dans ses bras et, après nous avoir adressé quelques paroles réconfortantes, regagne sa voiture, sans tourner la tête.
Il est environ 22 heures. Le coup de force Japonais du 9 mars 1945 vient pour nous de commencer.
Sitôt notre père parti, nous nous habillons promptement mon frère et moi, tandis que notre mère s’occupe de notre petite sœur.
Je contemple mon bureau où sont rassemblées mes affaires pour le lendemain et, réalisant qu’il n’y aura pas classe, je regrette amèrement d’avoir fait mon travail scolaire. Du coup, j’en oublie mon stylo, cadeau de première communion auquel je tiens particulièrement. Mon frère, lui, n’a pas oublié le sien ; il remplit ses poches de nombreux objets, dont un lance-pierres, pour protéger la famille et, au moment de partir, me glisse mon chapelet dans une poche.
L’ordonnance est venu nous rejoindre ; il n’est pas rassuré du tout. Notre mère lui confie les valises et il nous suit, tandis que nous empruntons, dans la nuit noire, le petit chemin de terre qui permet de rejoindre l’infirmerie.
Nous passons devant la villa du Commandant d’armes, tout éclairée, où de nombreuses familles d’officiers de la Légion sont venues se réfugier. Sa fille aînée que nous rencontrons quelques mètres plus loin nous invite à l’accompagner chez ses parents, mais nous déclinons son offre et suivons la consigne paternelle qui est de nous rendre à l’infirmerie.
Quelques instants plus tard, nous parvenons au tronçon de route qui permet de rejoindre l’embranchement HANOI-SONTAY. Notre mère donne congé à l’ordonnance en lui recommandant de bien garder la maison.
Nous avons quelques difficultés à traverser cette route sur laquelle circulent soldats, chevaux, véhicules et il nous faut encore un certain temps pour parvenir à l’infirmerie de garnison.

Un infirmier militaire, resté sur place, nous y accueille. Quelques familles sont déjà arrivées, d’autres le feront bientôt jusqu’à ce que nous parvenions à un total d’une quarantaine de personnes ; nous nous installons dans la salle d’attente.
Tout le monde bien sûr s’interroge sur notre sort futur, tandis que sur la route en contrebas, les
militaires de la garnison poursuivent leur repli.
Vers minuit, l’infirmier propose d’aller coucher les enfants les plus grands dans les chambres de malades inoccupées, ce que tout le monde accepte bien volontiers.
A 4 heures, une violente explosion réveille en sursaut les enfants qui, terrorisés, redescendent vers la salle d’attente. Il en manque deux et notre mère, inquiète de ne pas voir ses fils le signale à l’infirmier qui remonte à l’étage et les retrouve profondément endormis. Mon frère et moi rejoignons le groupe en salle d’attente.
L’infirmier pense que l’on a fait sauter la poudrière. Nous attendons l’attaque japonaise, tandis que les derniers éléments de ce que l’on appellera plus tard la colonne ALESSANDRI quittent la garnison.
Tout à coup, retentissent des explosions d’obus de plus en plus nourries, dont le bruit infernal se rapproche de nous. L’infirmier nous emmène rejoindre les tranchées qui se trouvent légèrement en arrière des deux bâtiments de l’infirmerie.
L’attente est de courte durée. Des crépitements de mitrailleuses, de nombreux coups de fusil se font entendre, de plus en plus près. C’est alors qu’un groupe de tirailleurs tonkinois complètement paniqués, sans arme ou le fusil en bandoulière, poursuivis par une vague hurlante de fantassins japonais débouche entre les deux bâtiments.
Les plus rapides s’enfuient à toutes jambes vers le petit bois qui nous fait face, tandis que leurs poursuivants, hurlant toujours, s’arrêtent, épaulent et leur tirent dessus. Certains tirailleurs sautent dans les tranchées où nous nous trouvons.
L’un d’eux, qui vient brusquement de faire demi-tour, tombe entre l’infirmier et moi, tremblant de peur. Un Japonais se retourne et le met immédiatement en joue. L’infirmier, habillé de sa tenue de service bleue, lève aussitôt les deux bras.
Le tirailleur terrorisé continue de trembler de tous ses membres ; le canon du fusil japonais est à proximité de sa tête et le coup prêt à partir. L’infirmier lui attrape le bras gauche, le lève et, d’un signe de tête, m’indique d’en faire autant avec son bras droit.
Mais l’intéressé a vite compris le geste salvateur et le Japonais, constatant qu’il n’est pas armé, le laisse et part à la poursuite des fuyards. Entre temps, d’autres soldats sont arrivés, poussant eux aussi leur cris guerriers.
Ils sont assez excités et, s’attendant à une forte résistance, très désemparés de se retrouver devant un groupe de femmes et d’enfants. Assez vivement, ils nous font sortir des tranchées et nous emmènent sur un petit chemin situé en contrebas.
Ils nous alignent le long du fossé qui le borde, tandis qu’ils s’installent sur le talus situé de l’autre côté. Ils nous font face et sont très agités. Ils aiguisent rageusement leurs baïonnettes dans le sol, puis nous mettent en joue.
Quelques instants après, une pièce mitrailleuse se met en batterie face à nous ; le chargeur engage une bande, tandis que le chef de pièce règle son arme sur notre groupe. Vont-ils déclencher le feu ? Le sous-officier chef de pièce semble hésiter et, se dressant, regarde vers la droite, dans la direction du chemin.
Quelques instants après apparaît, sur notre gauche, la silhouette d’un militaire gravissant la côte qui se dirige vers nous. Au moment où il nous aperçoit, il hurle ses ordres à la troupe. La pièce mitrailleuse se replie immédiatement et les soldats quittent leur emplacement. L’homme se rapproche de nous.
C’est un capitaine japonais. Parvenu à notre hauteur, il s’adresse à nous en Anglais, demandant si quelqu’un parmi nous parle Anglais. Notre mère s’avance d’un pas et lui répond. Il faut, au passage, souligner son extraordinaire sang froid ; quelques secondes auparavant, comme elle me le confiera plus tard, elle pensait : « Mon Dieu, s’ils doivent nous tuer, qu’ils nous tuent tous les quatre. » A présent, elle écoute, dans une langue qui n’est la sienne, cet officier qui s’adresse à elle et, se tournant vers notre groupe, traduit ses paroles : « Il nous dit de ne plus avoir peur, que c’est lui qui va s’occuper de nous maintenant et qu’il va nous ramener en bas rejoindre les autres personnes ». Notre mère lui demande si nous pouvons récupérer nos affaires dans le bâtiment de l’infirmerie et il est d’accord.
Nous descendons derrière lui le chemin qui dessert l’infirmerie et nous rejoignons la route de
SON TAY, à hauteur d’un bâtiment de la caserne des légionnaires. De très nombreuses personnes ont été amenées là par les Japonais qui les ont fait asseoir par terre sur la route.
L’officier qui nous a accompagnés nous fait asseoir au milieu d’eux et nous quitte. Il y a un grand nombre de femmes et d’enfants que je ne connais pas, mais qui sont probablement les familles des nombreux civils présents.
Il y a également quelques militaires capturés par les Japonais. Je reconnais l’un d’eux, un chauffeur de camion, et m’assieds à côté de lui. Il tient dans sa main droite son bras gauche ensanglanté. « Fais gaffe petit » me dit-il, ils ont la baïonnette facile ! Un pas de côté en trop et tu y as droit. Regarde ! » Et il me montre d’autres de ses camarades qui ont été blessés de la même façon à la jambe ou au bras. Je suis très impressionné.
Au bout de quelque temps, nous sommes rejoints par Madame MARCELLIN, accompagnée des femmes et des enfants qui s’étaient réfugiés chez elle, escortés par des Japonais. Ils nous apprennent que nos maisons ont été entièrement pillées et qu’ils ont vu des hordes de pillards passer devant eux avec nos affaires.
Madame MARCELLIN s’adresse alors à un officier japonais qui lui demande d’attendre et va chercher un interprète. Elle exprime son souhait de parler au commandant des troupes qui arrive quelque temps après.
Elle lui demande s’il a vu son mari qui est chargé de lui rendre la Place de TONG et, comme celui-ci lui répond par la négative, elle lui indique où se trouve son bureau. L’officier repart.
Les Japonais nous font lever puis font sortir des rangs tous les militaires et les emmènent. C’est le tour des hommes civils. Ils passent parmi nous et désignent ceux qui doivent partir. L’un d’eux saisit par le bras un garçon d’environ 16 ans, de grande taille, qui est auprès de sa mère. Celle-ci pousse un hurlement et s’interpose entre son fils et le soldat qu’elle menace de griffer au visage. Le Japonais interloqué recule et lui laisse son fils.
Les hommes sont emmenés à leur tour et suivis peu après par les familles civiles. Seules restent regroupées sur place les familles de militaires.
C’est à notre tour de partir. Nous remontons la rue, passons devant le quartier de notre père, dans lequel circulent de nombreux Japonais, puis nous longeons la cour du bureau de garnison où gisent quelques cadavres de militaires français et où un sous-officier d’origine antillaise est attaché à un arbre.
Nous parvenons à l’entrée de la caserne de la Légion où l’on nous fait attendre. C’est alors que je vois un capitaine d’aviation, entouré par des Japonais en armes, pénétrer dans le Bureau de la place.
Quelque temps après, le commandant des troupes japonais revient vers nous ; il est furieux. Il n’a pas trouvé le Colonel MARCELLIN.
Il est environ 8 heures du matin lorsque nous franchissons la porte de la caserne et sommes dirigés vers les locaux disciplinaires qui se trouvent à l’entrée, sur la gauche. A l’opposé du bâtiment, il y a une petite cellule d’isolement prévue pour un ou deux hommes.
On nous y enferme tous à titre de représailles, car les Japonais estiment que nous nous sommes moqués d’eux en leur indiquant la présence, dans son bureau, du Commandant d’armes introuvable.
Nous sommes ainsi 84 femmes et enfants, enfermés, tassés les uns contre les autres et tellement serrés que les gardes ne parviennent pas à fermer la lourde porte métallique. Heureusement, car nous serions promis à une asphyxie certaine. Deux fillettes ont la rougeole et les jeunes mères, relayées ou aidées par d’autres femmes, portent les bébés le plus haut possible pour leur permettre de respirer.
Alors commence une longue et angoissante attente. Comme on pouvait s’en douter, au bout de deux heures environ, de jeunes enfants manifestent un besoin pressant.
On demande aux geôliers si l’on peut les laisser sortir quelques instants ; ceux-ci se concertent et acceptent finalement, moyennant la remise d’une montre. Dès lors, toute personne qui souhaite sortir est taxée d’une montre.
Bientôt, fatigués de tenir cette comptabilité, les Japonais exigent la remise de la totalité des montres, en échange de quelques minutes à l’extérieur et à tour de rôle. Je suis à ce moment là à côté d’une amie de mon âge. Elle porte une montre que son père lui a donnée et à laquelle elle tient par-dessus tout.
Je lui dis : « cache-la », ce qu’elle s’apprête à faire, lorsque sa mère s’en aperçoit et l’oblige à la donner, par solidarité, mais aussi par crainte d’une fouille à la sortie.
Il fait de plus en plus chaud, mais tout le monde tient le coup. Vers 15 heures, on demande à Madame MARCELLIN de venir, car on a, semble-t-il, retrouvé son mari. Ses deux filles l’accompagnent, l’aînée laissant ses deux jeunes enfants à notre garde. Vers 16 heures, on nous fait sortir et nous apprenons que le Commandant d’armes a été retrouvé dans son bureau, le corps criblé de balles et de coups de baïonnette.
Les Japonais, guidés par le capitaine d’aviation qui ne connaissait pas les lieux, l’ont vainement cherché au rez-de-chaussée, alors que son bureau se trouvait à l’étage.
Les Japonais nous conduisent alors vers l’un des deux grands bâtiments de la caserne, celui qui se situe à droite de la porte d’entrée.
Au rez-de-chaussée se trouvent quelques bureaux ou locaux de service et la bibliothèque du corps, dont les dimensions correspondent à celles de deux chambres de 20 hommes.
La superficie en est réduite, en raison de la disposition à la périphérie des armoires à livres et la présence dans la pièce de sièges et de tables de lecture. Les Japonais nous affectent cette salle pour nous y installer.
Nous montons à l’étage supérieur, où se trouvent les chambres des légionnaires, et une chaîne s’organise pour en descendre les matelas et les couvertures qui nous permettront de passer la nuit.
Au même moment arrive un groupe de 91 femmes et enfants, provenant de la cité des sous-officiers. Les Japonais leur assignent deux chambres de troupe à l’étage pour s’y installer.
Nous sommes maintenant 175 femmes et enfants détenus dans cette caserne. Le bâtiment d’en face est en partie réservé aux prisonniers militaires, regroupés à l’étage supérieur. Ils sont peu nombreux, mais on en voit arriver de nouveaux, capturés après de durs combats, malgré leur infériorité en nombre et en équipement.
Nous nous organisons pour passer la nuit et disposons nos matelas les uns contre les autres, en nous regroupant par famille. La grande porte vitrée est fermée et on décide que les garçons les plus grands dormiront sur les matelas disposés à l’entrée, contre la porte. Nous sommes mon frère et moi au nombre de ceux-là.
Vers 23 heures, Madame MARCELLIN et ses filles reviennent. Le Colonel vient de mourir et nous apprenons en même temps qu’à l’Ecole militaire de TONG, le capitaine VAN VEYENBERG et l’adjudant-chef DRIESCH ont été sauvagement exécutés. A quelques exceptions près, les militaires qui n’avaient pas quitté la garnison ont subi le même sort.
Madame MARCELLIN, ses filles et ses petites filles s’installent sur les matelas réservés à leur intention. Blotties l’une contre l’autre, elles sanglotent. Les lumières s’éteignent, tout le monde pleure ; chacune des femmes pense à son mari et revit en pensée les terribles épreuves que nous venons de traverser.
La vie reprend le lendemain matin. Trois femmes vont s’imposer tout naturellement pour organiser la vie collective et répartir les tâches. Ce sont l’épouse du commandant de l’Ecole militaire, celle du médecin chef et notre mère.
Elles comptent parmi les moins jeunes de ce groupe de femmes qui, hormis l’épouse du Colonel, ont toutes moins de quarante ans. Elles sont assistées par un capitaine français dont la compagnie de tirailleurs est tombée dans une embuscade japonaise. Il s’est vaillamment défendu mais, à court de moyens et d’appuis, a dû se rendre. Il assure la liaison entre nous et le commandement de la caserne.
Deux légionnaires ont été réquisitionnés comme cuisiniers. Nous disposons chacun d’une gamelle et d’une cuiller. Ce sont les garçons qui ont réussi à en trouver en furetant un peu partout dans les locaux vides. Ils ont même trouvé des maillots de footballeur qui sont très appréciés des mamans qui les utilisent comme blouse.
Les repas consistent en une soupe à midi et une soupe le soir. La cuisine est installée dans un petit bâtiment situé derrière le nôtre et ce sont les plus grands qui vont chercher les marmites. Nous mangeons debout, dans un local qui renferme quelques tables métalliques.
Dans la journée, les matelas sont entassés sur le pourtour de la pièce, de façon à pouvoir circuler. Le soir, les dispositions sont prises pour dormir et la porte est fermée à clef jusqu’au lendemain matin. Personne ne se risque à quitter la pièce.
Nous sommes cependant complètement isolés et les Japonais ne pénètrent jamais dans notre bâtiment. Ils nous laissent d’ailleurs jouer dans la cour, au ballon…prisonnier ! Cela les amuse beaucoup de nous voir et l’un d’eux ira même un jour chercher de la farine pour matérialiser les limites du terrain.
Une épidémie de rougeole se déclare ; les enfants qui ne sont pas immunisés contractent la maladie, ce qui est le cas de notre petite soeur. Trois médecins japonais interviennent et soignent les enfants avec beaucoup de dévouement.
Un jour, nous recevons la visite de l’aumônier militaire. Une jeune maman lui demande de baptiser son bébé. Nous lui trouvons une bouteille de limonade vide qu’il remplit d’eau. Il officie au milieu de la pièce et nous participons à la cérémonie, groupés en rond autour de lui. Le désarroi de cette jeune mère, qui fait baptiser son enfant à la hâte, reflète bien le moral qui anime ses compagnes de captivité.
Nous vivons au jour le jour, ignorant tout du lendemain et l’angoisse est grande. Les enfants, l’insouciance de la jeunesse aidant, vivent cela moins durement.
Voulant savoir à quoi s’en tenir sur sa maison, notre mère demande un laissez-passer pour pouvoir s’y rendre en compagnie de deux autres dames. L’autorisation leur est accordée et elles partent en début d’après-midi.
Au moment où elles arrivent à la porte de notre jardin, elles constatent que la maison est occupée par des Japonais. Bien que ses deux amies l’en dissuadent, elle décide malgré tout d’y pénétrer seule. Il ne reste effectivement plus rien que les murs et, à l’étage, quelques Japonais allongés sur deux draps dont notre mère s’empare avant de rejoindre ses amies qui, au retour, renonceront à passer chez elles.
Le 21 mars, après 11 jours de détention, les Japonais décident de nous loger dans les bâtiments vides de la cité des cadres de l’Ecole militaire. Ceux-ci ont été libérés, car les familles qui les occupaient se sont, en raison des circonstances, regroupées à plusieurs par pavillon.
Nous rassemblons nos affaires, mais, avant de quitter les lieux, de nombreuses femmes qui détiennent une arme à feu remise par leur mari, c’est le cas de notre mère, décident de s’en débarrasser ; elles craignent en effet d’être fouillées à la sortie, ce qui ne s’est jamais produit jusqu’à présent.
Elles cachent leurs armes en haut des armoires ou derrière les rangées de livres. Les Japonais qui s’intéressaient à la lecture des ouvrages français auront probablement fait des découvertes insoupçonnées.
Au moment où ce groupe de 175 personnes que nous constituons va se séparer, je tiens à souligner la relativité de mon témoignage en apportant les précisions suivantes :
– D’après ce que j’en sais, l’agglomération de TONG-SONTAY comprenait, à cette époque, 650 familles environ ; le groupe que nous formions en représentait une soixantaine. J’ignore la façon dont ces autres familles ont vécu ces événements. Il convient de noter qu’aucun de mes camarades de classe, garçon ou fille, n’était avec moi. Je ne les ai par la suite jamais revus.
– Les familles les plus exposées ont paradoxalement été celles qui se sont réfugiées à l’infirmerie de garnison. Si le comportement digne et humain d’un capitaine japonais, qui a su maîtriser sa troupe, a permis d’y éviter un massacre, d’autres Japonais, nous l’avons vu, ont fait preuve d’une extrême sauvagerie.
Après avoir franchi la porte de la caserne, nous tournons à droite en sortant, puis une nouvelle fois, pour emprunter la route qui mène à l’Ecole militaire. Nous longeons le mur derrière lequel se trouve le bâtiment des prisonniers militaires.
Ils nous entendent passer et se précipitent aux fenêtres munies de barreaux. Nous en reconnaissons quelques uns. Ils nous appellent, cherchent si l’un des leurs est parmi nous, donnent leur nom pour que l’on prévienne leur femme ou leur compagne qu’ils sont détenus par les Japonais. Certains griffonnent quelques mots à la hâte sur un papier et nous l’envoient, mais bien peu arrivent à destination.
Nous poursuivons notre parcours à pied et arrivons à la cité des cadres qui borde l’Ecole militaire de TONG. Comme nous devons nous regrouper à plusieurs familles par pavillon, une amie de notre mère, épouse d’un commandant d’aviation, lui propose de s’installer avec nous dans un logement de trois pièces.
Elle a quatre enfants âgés de trois à onze ans, mais elle a en plus avec elle une jeune fille de seize ans et un garçon de quatorze ans dont les parents habitent en Haute région ; ils sont pensionnaires au lycée et elle leur sert de correspondant. En raison des événements, ils sont revenus chez elle.
Le 9 mars, son mari était en mission loin de TONG et elle ignore où il est. Elle habite un pavillon de cinq pièces qui est libre, mais craint d’y retourner, car il est situé en bordure du cantonnement japonais. Elle se contente d’y récupérer quelques affaires, dont la bicyclette de son mari. Nous nous installons donc à onze, deux femmes et neuf enfants, dans un trois pièces, entièrement meublé, dont les occupants sont partis.
La porte d’entrée a été forcée et ne ferme plus. Mon frère et le garçon de quatorze ans couchent au rez-de-chaussée et le reste des occupants dans les deux chambres situées à l’étage. Le soir on pousse le buffet contre la porte d’entrée pour empêcher, sinon retarder une éventuelle intrusion.
Il y a un petit jardin dans lequel se trouvent les dépendances dont la cuisine. Le ravitaillement est assuré par des commerçants locaux qui passent et nous vendent à prix d’or quelques denrées. Notre mère obtiendra une fois la permission de se rendre à bicyclette au marché de SONTAY, mais ne recommencera plus, car c’est une opération risquée et hasardeuse, compte tenu des hordes de pillards qui sévissent dans la région.
En fait chacun reste chez soi et l’on sort le moins possible, pour des raisons de sécurité. Les occupantes de quelques pavillons situés en bordure de cité sont agressées une nuit par des Indochinois. Elles crient pour appeler à l’aide et ce sont les Japonais qui viennent les secourir. Le lendemain, ils renforceront le dispositif de sécurité et distribueront des sifflets aux femmes pour donner l’alerte, mais elles n’auront pas à s’en servir.
Nous sommes totalement coupés de tout contact extérieur et nous n’avons bien sûr aucune nouvelle des troupes qui ont quitté la garnison. Un soir, alors que nous sommes tous à table entrain de dîner, un officier japonais pénètre dans notre pavillon, nous salue très aimablement et s’assied dans un fauteuil du salon.
C’est un médecin capitaine. Comme il parle Anglais, notre mère lui demande ce qu’il veut, mais il lui répond qu’il est simplement venu nous voir. Il reviendra ainsi régulièrement tous les soirs jusqu’à notre départ de TONG. Il arrive vers 19 heures, s’installe, nous regarde vivre et cherche à reconstituer les familles, en devinant à quelle mère correspond chacun des enfants.
Il est toujours d’une grande courtoisie et lorsque vers 20 heures 30, notre mère lui signifie que nous allons nous coucher, il se retire immédiatement en nous saluant très poliment.
Trois semaines environ, après notre installation dans ce pavillon, nous apprenons que nous allons quitter TONG à destination de HANOI, où les Japonais ont entrepris de regrouper tous les Français du Tonkin. C’est alors un défilé ininterrompu d’acheteurs indochinois qui cherchent à se procurer au moindre prix les biens d’équipement que nous ne pourrons bien sûr pas emporter.
L’ancienne occupante des lieux demande que l’on vende ses affaires le mieux possible, ce dont se chargeront, et non sans mal, les deux mères.
Le 21 avril 1945, en fin d’après-midi, encadrés par des militaires japonais, nous quittons TONG à pied, à destination de SONTAY, distante de 3 Km. Nous embarquons à bord de la chaloupe, bateau à vapeur mû par une roue à aubes.
Au moment où nous arrivons à bord, nous rencontrons notre brave et ancien cuisinier de HANOI, qui en, raison de son âge et de ses contraintes familiales, avait du nous quitter au moment de notre départ pour TONG. Il nous invite très gentiment à prendre une consommation au bar et donne à notre mère toutes indications nous permettant de faire appel à lui à HANOI, au cas où nous serions en difficulté.
Nous appareillons assez tard et parvenons à destination le lendemain matin. Nous sommes accueillis et enregistrés par des employés de la mairie de HANOI. On m’a donné en guise de petit déjeuner une banane dont je jette la peau dans un coin après l’avoir mangée. Une jeune Indochinoise, de mon âge, qui porte son petit frère se précipite dessus et la mange. Je suis effaré ! J’ai déjà fait cette expérience et ne l’ai jamais renouvelée.
Nos amis de TONG ont décidé de rester avec nous. Toutefois, la jeune fille de seize ans et son frère vont être hébergés par des religieuses, en attendant de retrouver leurs parents. Nous nous installons dans le logement de fonction d’un fonctionnaire de l’enregistrement célibataire, qui conserve une chambre pour lui et met à notre disposition le reste de la maison et son cuisinier.
Mais le pauvre homme, rapidement débordé par la présence de deux femmes et sept enfants, ira désormais dormir chez des amis. Sa générosité et la façon dont il nous a accueillis méritent reconnaissance et admiration.
Très rapidement, je comprends pourquoi la jeune Indochinoise a mangé aussi avidement la peau de banane que j’ai jetée. Des hordes de pauvres gens affamés, paysans pour la plupart, ont envahi la ville, dans l’espoir d’y trouver à manger, en raison d’une sévère famine qui sévit au Tonkin. Ils s’attaquent aux personnes et aux convois de charrettes de riz. Décharnés, affaiblis, ils meurent par centaines ; les cadavres sont entassés sur de petites voitures à bras qui sillonnent la ville et recouverts d’une bâche. Un système de cartes de ravitaillement a été mis en place et nous parvenons à subsister grâce à cela.
Bientôt, nous retrouvons nos anciens amis de HANOI. Les pères des familles de militaires sont presque tous prisonniers dans la citadelle, à l’exception bien sûr de ceux qui ont été tués au cours de combats violents et meurtriers contre les Japonais.
Toutefois, les médecins militaires affectés à l’Hôpital de LANESSAN ont été libérés et ont pu y reprendre leurs fonctions, ce qui nous permet d’y être soignés comme auparavant. Il faut cependant noter que l’accès à cet hôpital est sévèrement contrôlé par les Japonais. Les blessés graves ont également été libérés.
La plupart de nos amis qui, malgré les événements, ont conservé leurs biens nous viennent en aide en nous donnant des vêtements, des livres ou autres objets indispensables que nous n’avons pas les moyens d’acheter.
La ville est maintenant sous domination japonaise et un couvre-feu a été instauré. Les services administratifs français fonctionnent normalement, à l’exception de l’enseignement qui n’est pas assuré.
Vers la fin du mois d’avril, nous recevons, oh ! Stupeur, la visite du médecin japonais de TONG, qui nous apporte un énorme sac de bonbons. Comment a-t-il fait pour nous retrouver, je me le demande encore, alors que nous ne lui avions jamais communiqué nos noms, et que nous ignorions totalement où nous allions habiter lorsque nous avons débarqué à HANOI.
Comme il est au fond assez sympathique, nous lui demandons, en lui montrant son sabre, si, comme les samouraïs, il se fera Hara Kiri lorsque le Japon perdra la guerre. Avec un sourire un peu triste, il nous répond que cette éventualité ne se présentera jamais car le Japon, qui est la plus grande puissance mondiale, en sortira vainqueur. La capitulation allemande qui interviendra quelques jours plus tard nous permettra d’en douter.
Les Indochinois commencent à manifester leurs velléités d’indépendance et certains adoptent, vis à vis de nous, un comportement hostile. Alors qu’un jour mon frère, notre ami et moi rentrons chez nous en fin d’après midi, nous sommes agressés par une quinzaine de garçons de notre âge, qui s’emparent de la bicyclette que mon frère tient à la main.
Un étudiant indochinois, qui vient d’assister à la scène, s’adresse à eux dans leur langue et leur explique qu’ils vont bientôt acquérir leur indépendance et qu’ils se doivent de montrer l’exemple. Il les oblige à nous rendre la bicyclette, ce qu’ils font de mauvaise grâce. Mais ce comportement tolérant restera malheureusement l’exception.
A la fin du mois de mai, notre pavillon est réquisitionné par les Japonais et nous devons quitter les lieux. Nous sommes de ce fait, obligés de nous séparer de nos amis.
La quasi totalité des Français du Tonkin a été regroupée sur HANOI et il est très difficile de se loger. Toutefois, un capitaine d’aviation, marié depuis peu à une Eurasienne, nous héberge chez lui. Victime, quelques mois auparavant d’un grave accident d’avion, il était hospitalisé le 9 mars et n’a donc pas été interné.
Nous habitons maintenant rue Duvignau, en plein quartier indochinois. Nos hôtes sont charmants. Ils n’ont pas d’enfant et nous partageons totalement leur vie. Un jeune couple indochinois, à leur service, prépare les repas en utilisant les ressources locales et nous apprenons à consommer sous toutes leurs formes et toutes leurs couleurs, fleurs comprises, la banane et la papaye.
Ces personnes ont également recueilli chez elles l’ancien administrateur de SON LA, localité située en pays THAI. Il a vu passer chez lui des éléments de la colonne ALESSANDRI, dont le Général, qui ont poursuivi leur retraite vers la Chine, mais n’a pas vu notre père, ni d’ailleurs aucun de ses officiers. C’est la première fois que nous avons une information sur les militaires qui sont partis de TONG, mais cela ne diminue en rien notre inquiétude.
Nous sortons de moins en moins. Le quartier où nous habitons n’est pas sûr. Nous avons retrouvé comme voisin un ancien camarade du lycée Albert Sarraut. C’est le fils d’un adjudant antillais, marié à une Indochinoise.
Une quinzaine de jours avant notre arrivée, ils ont, sa mère, sa sœur et lui été agressés à domicile ; il a courageusement défendu sa famille et a été blessé au bras en esquivant un coup de couteau, dont il nous montre fièrement la cicatrice. Il nous parle de son père qui était prisonnier à la Citadelle et qui est maintenant, comme nombre de ses codétenus, au camp de HOA BINH, devenu tristement célèbre.
Le 7 août 1945, nous apprenons le bombardement de HIROSHIMA avec un grand soulagement. Nous ne connaissons pas bien sûr les effets pervers de l’arme atomique, mais nous souhaitons ardemment que cela précipite la défaite japonaise. Puis ce sera NAGASAKI et enfin la capitulation tant attendue du Japon.
Un grand espoir naît en nous, qui ne sera malheureusement que de courte durée. D’autres épreuves nous attendent et c’est une année terrible et bien noire que nous vivrons avant notre retour en métropole.
Mais, comme je ne veux pas laisser mon auditoire sur une triste impression, je vous propose, en guise d’épilogue, ce «happy end» :
Le 21 décembre 1946, notre mère, accompagnée de notre petite sœur, part pour Paris, accueillir notre père rentrant d’Indochine.
Celui-ci, après nous avoir quittés le soir du 9 mars a, dès le lendemain, avec ses artilleurs, protégé le franchissement de la RIVIERE NOIRE par la colonne ALESSANDRI, sur des embarcations de fortune ; contraint de traverser la rivière à son tour, sous le feu ennemi, il a pris soin auparavant de détruire la totalité de ses canons.
Quelques jours plus tard, il s’est vu confier le commandement d’un sous groupement qui, au fil des jours et par suite de la démobilisation des soldats d’origine indochinoise, n’était pratiquement plus constitué que de cadres.
Coupé de ses chefs, sans aucun appui extérieur, et après avoir livré de très durs combats, il a sauvé ses hommes, au bord de l’épuisement et en guenilles, en prenant seul la décision de passer en Chine.
Quelques mois plus tard, le Lieutenant-colonel QUILICHINI, désigné par le Général LECLERC pour prendre le commandement des troupes françaises de Chine le choisira comme chef d’état-major. Son comportement valeureux au cours de la campagne de retour en Indochine, en pays THAI, de janvier à décembre 1946, lui vaudra une brillante citation à l’ordre du corps d’armée avec attribution de la croix de guerre 1939-1945 et, quelques semaines après, une nomination au grade de chevalier de la Légion d’honneur.
Nous sommes pour notre part rentrés d’Indochine trois mois avant lui et installés à Nice chez nos grands-parents. A notre arrivée à Toulon, en septembre 1946, on nous a attribué le statut d’interné politique qui n’a par la suite pas été confirmé, étant donné que notre durée de détention est inférieure à trois mois.
Aux dernières nouvelles, nous serions considérés maintenant comme ayant été « confinés », ce qui, si l’on se réfère au Larousse, signifie : « enfermés dans d’étroites limites ». Après tout, pourquoi pas ? Toujours est-il qu’au retour, on nous a attribué à chacun, pendant six mois, deux cartes de ravitaillement ce qui, allié au climat bénéfique, m’a permis de prendre six kilos et de ressembler à mes camarades de classe.
Nous passons Noël chez nos grands-parents, ce qui ne nous était plus arrivé depuis 1938. Notre grand-père paternel s’est éteint quelques mois avant notre retour ; il a heureusement pu échanger quelques lettres avec son fils avant de mourir. Quelques jours plus tard, nous nous installerons dans son appartement, à Boulogne sur Seine.
Nous sommes rentrés d’Indochine avec pour tout bagage deux cantines dans chacune desquelles notre mère avait placé un gros coussin, pour caler nos affaires. Les Japonais et les Indochinois nous ont pris la totalité de nos biens, mais ils nous ont laissé le plus précieux de tous : la VIE.
Views: 15

